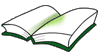BibliothĆØque de la FacultĆ© des sciences de la nature et de la vie universitĆ© USTOMB
DĆ©tail de l'indexation
|
|
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 304.2 (4)


 triƩ(s) par (Pertinence dƩcroissant(e), Titre croissant(e)) Affiner la recherche Interroger des sources externes
triƩ(s) par (Pertinence dƩcroissant(e), Titre croissant(e)) Affiner la recherche Interroger des sources externes
Titre : ƉlĆ©ments d'Ć©cologie humaine : une lecture de la mĆ©sologie Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : Jean-Michel Le Bot, Auteur Editeur : Paris : l'Harmattan AnnĆ©e de publication : 2014 Collection : Logiques sociales, ISSN 0295-7736 Importance : 1 vol. (240 p.) PrĆ©sentation : ill. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-343-04962-5 Note gĆ©nĆ©rale : Bibliogr. et webliogr. p. 219-237 Langues : FranƧais (fre) Index. dĆ©cimale : 304.2 RĆ©sumĆ© : La notion d'Ć©cologie humaine a connu de nombreuses dĆ©finitions qui posent dans tous les cas la question des relations entre l'humanitĆ© et l'environnement dit naturel. La mĆ©sologie, dĆ©veloppĆ©e en France par Augustin Berque, semble ĆŖtre l'un des modĆØles les plus prometteurs pour penser ces relations. Elle se dĆ©finit comme l'Ć©tude des milieux humains, dans une perspective qui insiste particuliĆØrement sur la mĆ©diation, dans les relations des hommes Ć leur environnement, des systĆØmes symboliques et techniques propres Ć l'humanitĆ©. ƉlĆ©ments d'Ć©cologie humaine : une lecture de la mĆ©sologie [texte imprimĆ©] / Jean-Michel Le Bot, Auteur . - Paris : l'Harmattan, 2014 . - 1 vol. (240 p.) : ill. ; 22 cm. - (Logiques sociales, ISSN 0295-7736) .
ISBN : 978-2-343-04962-5
Bibliogr. et webliogr. p. 219-237
Langues : FranƧais (fre)
Index. dĆ©cimale : 304.2 RĆ©sumĆ© : La notion d'Ć©cologie humaine a connu de nombreuses dĆ©finitions qui posent dans tous les cas la question des relations entre l'humanitĆ© et l'environnement dit naturel. La mĆ©sologie, dĆ©veloppĆ©e en France par Augustin Berque, semble ĆŖtre l'un des modĆØles les plus prometteurs pour penser ces relations. Elle se dĆ©finit comme l'Ć©tude des milieux humains, dans une perspective qui insiste particuliĆØrement sur la mĆ©diation, dans les relations des hommes Ć leur environnement, des systĆØmes symboliques et techniques propres Ć l'humanitĆ©. Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitĆ© 01666 21-01-107 livres Bibliothèque de la faculté S.N.V * HARCHE MERIEM* livres Consultation sur place
Exclu du prĆŖt01667 21-01-107 livres Bibliothèque de la faculté S.N.V * HARCHE MERIEM* livres prĆŖt possible
Disponible01668 21-01-107 livres Bibliothèque de la faculté S.N.V * HARCHE MERIEM* livres prĆŖt possible
DisponibleLes interactions hommes-milieux (2014)
Titre : Les interactions hommes-milieux : questions et pratiques de la recherche en environnement Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : Robert Chenorkian (1950-....), Ɖditeur scientifique ; Samuel Robert (1970-....), Ɖditeur scientifique Editeur : [Versailles] : Ɖd. Quae AnnĆ©e de publication : 2014 Collection : Indisciplines, ISSN 1772-4120 Importance : 1 vol. (180 p.) PrĆ©sentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7592-2187-5 Note gĆ©nĆ©rale : Notes bibliogr. Langues : FranƧais (fre) Index. dĆ©cimale : 304.2 RĆ©sumĆ© : Jusqu'Ć l'arrivĆ©e de l'Homo sapiens, les milieux ont Ć©tĆ© relativement peu affectĆ©s par les activitĆ©s humaines. Par la suite, avec l'accumulation des acquis techniques et idĆ©ologiques, l'homme a exercĆ© une influence croissante sur l'environnement. L'ensemble des relations caractĆ©risant l'influence des milieux sur les actions et le fonctionnement des sociĆ©tĆ©s humaines, et l'effet des activitĆ©s et des dĆ©cisions humaines sur les milieux, constitue les "interactions hommes-milieux".
L'objectif des Observatoires hommes-milieux est d'Ć©laborer un cadre conceptuel, Ć©pistĆ©mologique et opĆ©rationnel Ć l'Ć©tude interdisciplinaire de ces interactions. Cette dĆ©marche repose sur la collaboration entre diverses disciplines scientifiques et sur des Ć©changes entre la sphĆØre scientifique et les acteurs sociaux, qu'ils soient politiques, associatifs ou Ć©conomiques.
Il s'agit notamment d'Ć©clairer les enjeux actuels liĆ©s au changement global et Ć la mondialisation des activitĆ©s humaines, particuliĆØrement ceux touchant Ć la biodiversitĆ©, Ć la vulnĆ©rabilitĆ© des milieux et des territoires, aux incidences sur les ressources et Ć la santĆ© des populations.
Issus de diverses disciplines scientifiques, des chercheurs ont Ć©tĆ© sollicitĆ©s pour apporter un libre point de vue sur le thĆØme "Penser l'observation et la recherche sur les interactions hommes-milieux". Rappels Ć©pistĆ©mologiques, recul sur la place du scientifique dans la sociĆ©tĆ©, propositions mĆ©thodologiques, discussion sur les pratiques de recherche et les attentes sociĆ©tales, en constituent les principaux apports.Les interactions hommes-milieux : questions et pratiques de la recherche en environnement [texte imprimĆ©] / Robert Chenorkian (1950-....), Ɖditeur scientifique ; Samuel Robert (1970-....), Ɖditeur scientifique . - [Versailles] : Ɖd. Quae, 2014 . - 1 vol. (180 p.) : ill. ; 24 cm. - (Indisciplines, ISSN 1772-4120) .
ISBN : 978-2-7592-2187-5
Notes bibliogr.
Langues : FranƧais (fre)
Index. dĆ©cimale : 304.2 RĆ©sumĆ© : Jusqu'Ć l'arrivĆ©e de l'Homo sapiens, les milieux ont Ć©tĆ© relativement peu affectĆ©s par les activitĆ©s humaines. Par la suite, avec l'accumulation des acquis techniques et idĆ©ologiques, l'homme a exercĆ© une influence croissante sur l'environnement. L'ensemble des relations caractĆ©risant l'influence des milieux sur les actions et le fonctionnement des sociĆ©tĆ©s humaines, et l'effet des activitĆ©s et des dĆ©cisions humaines sur les milieux, constitue les "interactions hommes-milieux".
L'objectif des Observatoires hommes-milieux est d'Ć©laborer un cadre conceptuel, Ć©pistĆ©mologique et opĆ©rationnel Ć l'Ć©tude interdisciplinaire de ces interactions. Cette dĆ©marche repose sur la collaboration entre diverses disciplines scientifiques et sur des Ć©changes entre la sphĆØre scientifique et les acteurs sociaux, qu'ils soient politiques, associatifs ou Ć©conomiques.
Il s'agit notamment d'Ć©clairer les enjeux actuels liĆ©s au changement global et Ć la mondialisation des activitĆ©s humaines, particuliĆØrement ceux touchant Ć la biodiversitĆ©, Ć la vulnĆ©rabilitĆ© des milieux et des territoires, aux incidences sur les ressources et Ć la santĆ© des populations.
Issus de diverses disciplines scientifiques, des chercheurs ont Ć©tĆ© sollicitĆ©s pour apporter un libre point de vue sur le thĆØme "Penser l'observation et la recherche sur les interactions hommes-milieux". Rappels Ć©pistĆ©mologiques, recul sur la place du scientifique dans la sociĆ©tĆ©, propositions mĆ©thodologiques, discussion sur les pratiques de recherche et les attentes sociĆ©tales, en constituent les principaux apports.Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitĆ© 01657 21-01-102 livres Bibliothèque de la faculté S.N.V * HARCHE MERIEM* livres Consultation sur place
Exclu du prĆŖt
Titre : RĆ©silience & environnement : penser les changements socio-Ć©cologiques Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : RaphaĆ«l Mathevet (1971-....), Auteur ; FranƧois Bousquet (1963-....), Auteur Editeur : Paris : Buchet-Chastel AnnĆ©e de publication : 2014 Importance : 1 vol. (169 p.) PrĆ©sentation : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. Format : 21 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-283-02736-3 Note gĆ©nĆ©rale : Bibliogr. p. 157-163 Langues : FranƧais (fre) Index. dĆ©cimale : 304.2 RĆ©sumĆ© : Dans la tempĆŖte, le roseau s'adapte : il plie et ne rompt point ; le chĆŖne rĆ©siste, mais, lorsqu'un seuil de perturbation est franchi, il se dĆ©racine. Dans le domaine de l'environnement, penser la rĆ©silience, c'est rĆ©flĆ©chir Ć la maniĆØre dont les systĆØmes socio-Ć©cologiques rĆ©pondent aux perturbations, s'adaptent tout en conservant leurs fonctions fondamentales et leur structure, ou se transforment : comment une barriĆØre de corail, une forĆŖt ou un marais Ć©voluent-ils d'un Ć©tat Ć un autre ? De quelle faƧon peut-on rĆ©duire la vulnĆ©rabilitĆ© d'une ville face aux cyclones ? Comment explorer les futurs possibles de l'agriculture ou amĆ©liorer la gestion des ressources naturelles ? Comment accroĆ®tre la rĆ©silience d'un territoire ? Ć€ partir d'exemples concrets issus de pays trĆØs divers Āæ Australie, Canada, Ɖtats-Unis, France, SuĆØde, Ukraine, SĆ©nĆ©gal, Tanzanie, ThaĆÆlande Āæ cet ouvrage explore le concept de rĆ©silience socio-Ć©cologique, dĆ©veloppĆ© ces quatre derniĆØres dĆ©cennies. Au moment oĆ¹ notre planĆØte connaĆ®t des bouleversements importants, il est urgent de mieux comprendre les Ć©volutions de notre environnement et de vivre de faƧon plus rĆ©siliente. RaphaĆ«l Mathevet (CNRS) et FranƧois Bousquet (CIRAD ) sont chercheurs dans le domaine de l'environnement. Leurs travaux portent sur la conservation de la biodiversitĆ© et la gestion concertĆ©e des ressources naturelles et renouvelables. Ils appartiennent au rĆ©seau international de recherche Resilience Alliance. RĆ©silience & environnement : penser les changements socio-Ć©cologiques [texte imprimĆ©] / RaphaĆ«l Mathevet (1971-....), Auteur ; FranƧois Bousquet (1963-....), Auteur . - Paris : Buchet-Chastel, 2014 . - 1 vol. (169 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm.
ISBN : 978-2-283-02736-3
Bibliogr. p. 157-163
Langues : FranƧais (fre)
Index. dĆ©cimale : 304.2 RĆ©sumĆ© : Dans la tempĆŖte, le roseau s'adapte : il plie et ne rompt point ; le chĆŖne rĆ©siste, mais, lorsqu'un seuil de perturbation est franchi, il se dĆ©racine. Dans le domaine de l'environnement, penser la rĆ©silience, c'est rĆ©flĆ©chir Ć la maniĆØre dont les systĆØmes socio-Ć©cologiques rĆ©pondent aux perturbations, s'adaptent tout en conservant leurs fonctions fondamentales et leur structure, ou se transforment : comment une barriĆØre de corail, une forĆŖt ou un marais Ć©voluent-ils d'un Ć©tat Ć un autre ? De quelle faƧon peut-on rĆ©duire la vulnĆ©rabilitĆ© d'une ville face aux cyclones ? Comment explorer les futurs possibles de l'agriculture ou amĆ©liorer la gestion des ressources naturelles ? Comment accroĆ®tre la rĆ©silience d'un territoire ? Ć€ partir d'exemples concrets issus de pays trĆØs divers Āæ Australie, Canada, Ɖtats-Unis, France, SuĆØde, Ukraine, SĆ©nĆ©gal, Tanzanie, ThaĆÆlande Āæ cet ouvrage explore le concept de rĆ©silience socio-Ć©cologique, dĆ©veloppĆ© ces quatre derniĆØres dĆ©cennies. Au moment oĆ¹ notre planĆØte connaĆ®t des bouleversements importants, il est urgent de mieux comprendre les Ć©volutions de notre environnement et de vivre de faƧon plus rĆ©siliente. RaphaĆ«l Mathevet (CNRS) et FranƧois Bousquet (CIRAD ) sont chercheurs dans le domaine de l'environnement. Leurs travaux portent sur la conservation de la biodiversitĆ© et la gestion concertĆ©e des ressources naturelles et renouvelables. Ils appartiennent au rĆ©seau international de recherche Resilience Alliance. Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitĆ© 01636 21-01-95 livres Bibliothèque de la faculté S.N.V * HARCHE MERIEM* livres Consultation sur place
Exclu du prĆŖt01637 21-01-95 livres Bibliothèque de la faculté S.N.V * HARCHE MERIEM* livres prĆŖt possible
Disponible01638 21-01-95 livres Bibliothèque de la faculté S.N.V * HARCHE MERIEM* livres prĆŖt possible
DisponibleLes sciences humaines et les sciences du vivant face Ć la crise de la biodiversitĆ© / Alexandra Liarsou (2014)
Titre : Les sciences humaines et les sciences du vivant face Ć la crise de la biodiversitĆ© : enjeux contemporains et perspectives historiques Type de document : texte imprimĆ© Auteurs : Alexandra Liarsou (1982-....), Auteur Editeur : Paris : l'Harmattan AnnĆ©e de publication : 2014 Importance : 1 vol. (276 p.) PrĆ©sentation : couv. ill. en coul. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-343-02665-7 Note gĆ©nĆ©rale : Notes bibliogr. et webliogr. Glossaire Langues : FranƧais (fre) Index. dĆ©cimale : 304.2 RĆ©sumĆ© : Les pistes et les axes de rĆ©flexion dĆ©veloppĆ©s dans cet ouvrage tentent de rendre compte de la multiplicitĆ© des enjeux cristallisĆ©s autour de la notion de biodiversitĆ©, du fait qu'elle soit aujourd'hui patrimonialisĆ©e et considĆ©rĆ©e comme en crise par la sociĆ©tĆ©. AprĆØs une analyse de la mise en place du modĆØle Ć©conomique dit durable et des plans de gestion de la diversitĆ© du vivant, l'auteur Ć©voque les raisons pour lesquelles il semble que ce mode de dĆ©veloppement et les politiques associĆ©es soient tenus en Ć©chec.
L'argumentaire est forgĆ© Ć partir du constat que l'ingĆ©nierie Ć©cologique, chargĆ©e de la conservation des espĆØces et de la restauration de leurs milieux de vie, n'ait pas pris suffisamment en compte deux dimensions essentielles ; d'une part, le caractĆØre social de son objet d'Ć©tude, la BiodiversitĆ©, et, d'autre part, les dynamiques historiques de structuration des reprĆ©sentations et des interactions concrĆØtes des sociĆ©tĆ©s humaines Ć leurs milieux et aux autres espĆØces.
Pour l'auteur, l'ambition d'une meilleure adaptation Ć la dimension Ć©cologique passe par la thĆ©orisation de ce que signifie l'expression de la crise, en tant qu'atteinte d'un seuil de contradiction apparent entre nos comportements socio-Ć©conomiques et ce qu'il est convenu d'appeler la nature. Cet objectif appelle la mise en question des schĆ©mas mentaux sur lesquels s'appuient ces comportements. C'est toute une thĆ©orie de la connaissance, telle qu'elle s'est construite de maniĆØre dominante en Occident, qui est mise sur la sellette.
La majeure partie des ƩpistƩmologies disciplinaires et des partages de compƩtence entre sciences dites humaines et sciences dites dures sont Ʃgalement ƩbranlƩs par les tentatives malaisƩes de rƩsolution de ladite crise. Dans cet ouvrage, l'auteur insiste sur la vision dualiste et anthropocentrique encore dominante et en montre les Ʃcueils. Elle envisage les discours scientifiques et Ʃthiques qui remettent en cause cette conception du monde.
Elle dĆ©veloppe une rĆ©flexion historique sur les grandes Ć©tapes de construction de cette reprĆ©sentation du monde, essentiellement menĆ©e par le biais de l'Ć©volution statutaire de l'animal. Elle espĆØre ainsi permettre aux lecteurs d'entrevoir l'architecture problĆ©matique sous-jacente Ć la notion trĆØs mĆ©diatisĆ©e de perte de biodiversitĆ©.Les sciences humaines et les sciences du vivant face Ć la crise de la biodiversitĆ© : enjeux contemporains et perspectives historiques [texte imprimĆ©] / Alexandra Liarsou (1982-....), Auteur . - Paris : l'Harmattan, 2014 . - 1 vol. (276 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm.
ISBN : 978-2-343-02665-7
Notes bibliogr. et webliogr. Glossaire
Langues : FranƧais (fre)
Index. dĆ©cimale : 304.2 RĆ©sumĆ© : Les pistes et les axes de rĆ©flexion dĆ©veloppĆ©s dans cet ouvrage tentent de rendre compte de la multiplicitĆ© des enjeux cristallisĆ©s autour de la notion de biodiversitĆ©, du fait qu'elle soit aujourd'hui patrimonialisĆ©e et considĆ©rĆ©e comme en crise par la sociĆ©tĆ©. AprĆØs une analyse de la mise en place du modĆØle Ć©conomique dit durable et des plans de gestion de la diversitĆ© du vivant, l'auteur Ć©voque les raisons pour lesquelles il semble que ce mode de dĆ©veloppement et les politiques associĆ©es soient tenus en Ć©chec.
L'argumentaire est forgĆ© Ć partir du constat que l'ingĆ©nierie Ć©cologique, chargĆ©e de la conservation des espĆØces et de la restauration de leurs milieux de vie, n'ait pas pris suffisamment en compte deux dimensions essentielles ; d'une part, le caractĆØre social de son objet d'Ć©tude, la BiodiversitĆ©, et, d'autre part, les dynamiques historiques de structuration des reprĆ©sentations et des interactions concrĆØtes des sociĆ©tĆ©s humaines Ć leurs milieux et aux autres espĆØces.
Pour l'auteur, l'ambition d'une meilleure adaptation Ć la dimension Ć©cologique passe par la thĆ©orisation de ce que signifie l'expression de la crise, en tant qu'atteinte d'un seuil de contradiction apparent entre nos comportements socio-Ć©conomiques et ce qu'il est convenu d'appeler la nature. Cet objectif appelle la mise en question des schĆ©mas mentaux sur lesquels s'appuient ces comportements. C'est toute une thĆ©orie de la connaissance, telle qu'elle s'est construite de maniĆØre dominante en Occident, qui est mise sur la sellette.
La majeure partie des ƩpistƩmologies disciplinaires et des partages de compƩtence entre sciences dites humaines et sciences dites dures sont Ʃgalement ƩbranlƩs par les tentatives malaisƩes de rƩsolution de ladite crise. Dans cet ouvrage, l'auteur insiste sur la vision dualiste et anthropocentrique encore dominante et en montre les Ʃcueils. Elle envisage les discours scientifiques et Ʃthiques qui remettent en cause cette conception du monde.
Elle dĆ©veloppe une rĆ©flexion historique sur les grandes Ć©tapes de construction de cette reprĆ©sentation du monde, essentiellement menĆ©e par le biais de l'Ć©volution statutaire de l'animal. Elle espĆØre ainsi permettre aux lecteurs d'entrevoir l'architecture problĆ©matique sous-jacente Ć la notion trĆØs mĆ©diatisĆ©e de perte de biodiversitĆ©.Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section DisponibilitĆ© 01456 19-03-28 livres Bibliothèque de la faculté S.N.V * HARCHE MERIEM* livres Consultation sur place
Exclu du prĆŖt01457 19-03-28 livres Bibliothèque de la faculté S.N.V * HARCHE MERIEM* livres prĆŖt possible
Disponible01458 19-03-28 livres Bibliothèque de la faculté S.N.V * HARCHE MERIEM* livres prĆŖt possible
Disponible

 304.6
304.6