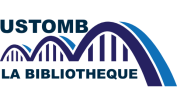les Thèses Soutenues à l'USTO MB
vous cherchez une thèse?
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les recherches... | Votre compte |
Catégories


 Faire une suggestion Affiner la recherche
Faire une suggestion Affiner la rechercheL’architecture hôtelière de Fernand Pouillon (1965-1984) : Principes, diversité typologique et composition pittoresque / MAACHI Myriam

Titre : L’architecture hôtelière de Fernand Pouillon (1965-1984) : Principes, diversité typologique et composition pittoresque Type de document : texte imprimé Auteurs : MAACHI Myriam, Auteur Année de publication : 2020-2021 Accompagnement : CD Langues : Français (fre) Catégories : Architecture:Architecture Mots-clés : PoPouillon-composition-hotels architecture-picturesque-contextualized.uillon- composition-architecture hôtelière-pittoresque-contextualisé
Pouillon-composition-hotels architecture-picturesque-contextualized.Résumé : Principalement concentrée en Algérie, l’oeuvre architecturale de Fernand Pouillon est énorme
(cités d’habitation, hôtels, mairies, cinémas …). Elle reflète une grande liberté de pensée sans
pour autant nier la continuité historique qui favorise le respect du lieu et revalorise l’architecture
vernaculaire méditerranéenne.
Partant du constat de la médiocrité de la production du cadre bâti, liée au problème de l’identité
architecturale algérienne, nous avons émis l’hypothèse que l’analyse des projets pouilloniens
pouvait nous donner des leçons en matière de composition et par conséquent participer à
l’amélioration de la production architecturale.
Cette thèse de doctorat vise l’identification des principes de composition de Fernand Pouillon.
Avec une gageure : « construire le plus beau tourisme de la méditerranée », Pouillon réalise
entre 1965 et 1984 une quarantaine d’hôtels ou villages de vacances qui forment le corpus de
notre recherche. L’analyse morphologique des projets va mettre en évidence leurs qualités
compositionnelles, de l’échelle du site à celle du détail, tandis que l’analyse typologique tentera
d’expliquer la diversité du langage sur les plans : contextuel, distributif et stylistique.
En effet, Pouillon compose avec le paysage de véritables mises en scène où les espaces urbains
sont travaillés avec soin.
Erudit, il aimait s’entourer d’artistes et d’artisans qui ont oeuvré sur tous ses chantiers ; n’est-il
pas, dans ce sens, un précurseur du développement durable ?
L’architecte propose une architecture aux références multiculturelles qui s’apparente à la
recherche d’un nouveau langage pour une société en quête d’identité.
Enfin, nous comprendrons pourquoi et comment Pouillon utilise l’approche pittoresque. En
effet, il aspire à réaliser des projets contextualisés, des lieux de convivialité où s’invitent des
fantaisies, des prétextes à la « promenade architecturale » où les cinq sens sont convoqués.
Paradoxalement, les adeptes du Mouvement moderne qui prônaient la « tabula rasa », au nom
de la modernité, n’ont-ils pas adopté les mêmes principes ?
Most of Fernand Pouillon’s body of work is located in Algeria. Its huge production is made of
housing, hotels, city halls, movie theaters and more…his architectural work reflects a great
freedom of thinking. However he keeps following historical continuity. Such a process
promotes respect of place and enhances value of Mediterranean vernacular architecture.
We started with an assessment: the very bad quality of build environment. This reality is related
to the problem of Algerian architectural identity. Therefore we stated a hypothesis: the analysis
of Pouillon’s projects will teach us lessons of design. Then we will participate to a better
architectural production in the future.
This PhD thesis aims an identification of Pouillon’s composition principles.
Following the challenge: “building the most beautiful tourism program in Mediterranean sea”,
Pouillon designed (between 1965 and 1984) 40 hotels, kind of holidays villages. These are
making the body of our research. The morphological study will show up their design qualities
from site scale to details. The typological study will try to explain language diversity in plans:
contextual, distributive and stylistic.
Actually Pouillon used landscape for real sceneries where urban spaces were carefully
elaborated. Harmony between architecture and landscape: isn’t it a picturesque principle?
Excellent scholar, this architect loved being surrounded with artists and craftsmen who worked
in all his building sites. Wasn’t he, somehow a precursor of sustainable development?
Pouillon proposes architecture with multicultural references. He searches a new language for a
society in quest of identity.
At last, we will understand why and how Pouillon used picturesque approach. Actually, he
wishes to build contextualized and welcoming places for whims. These ideas are supports to
“architectural promenade”.
Paradoxically, Modern Movement followers valued the “tabula rasa” in the name of modernity.
Didn’t they choose the same principles?
Directeur de thèse : MEGHFOUR KACEMI Malika L’architecture hôtelière de Fernand Pouillon (1965-1984) : Principes, diversité typologique et composition pittoresque [texte imprimé] / MAACHI Myriam, Auteur . - 2020-2021 . - + CD.
Langues : Français (fre)
Catégories : Architecture:Architecture Mots-clés : PoPouillon-composition-hotels architecture-picturesque-contextualized.uillon- composition-architecture hôtelière-pittoresque-contextualisé
Pouillon-composition-hotels architecture-picturesque-contextualized.Résumé : Principalement concentrée en Algérie, l’oeuvre architecturale de Fernand Pouillon est énorme
(cités d’habitation, hôtels, mairies, cinémas …). Elle reflète une grande liberté de pensée sans
pour autant nier la continuité historique qui favorise le respect du lieu et revalorise l’architecture
vernaculaire méditerranéenne.
Partant du constat de la médiocrité de la production du cadre bâti, liée au problème de l’identité
architecturale algérienne, nous avons émis l’hypothèse que l’analyse des projets pouilloniens
pouvait nous donner des leçons en matière de composition et par conséquent participer à
l’amélioration de la production architecturale.
Cette thèse de doctorat vise l’identification des principes de composition de Fernand Pouillon.
Avec une gageure : « construire le plus beau tourisme de la méditerranée », Pouillon réalise
entre 1965 et 1984 une quarantaine d’hôtels ou villages de vacances qui forment le corpus de
notre recherche. L’analyse morphologique des projets va mettre en évidence leurs qualités
compositionnelles, de l’échelle du site à celle du détail, tandis que l’analyse typologique tentera
d’expliquer la diversité du langage sur les plans : contextuel, distributif et stylistique.
En effet, Pouillon compose avec le paysage de véritables mises en scène où les espaces urbains
sont travaillés avec soin.
Erudit, il aimait s’entourer d’artistes et d’artisans qui ont oeuvré sur tous ses chantiers ; n’est-il
pas, dans ce sens, un précurseur du développement durable ?
L’architecte propose une architecture aux références multiculturelles qui s’apparente à la
recherche d’un nouveau langage pour une société en quête d’identité.
Enfin, nous comprendrons pourquoi et comment Pouillon utilise l’approche pittoresque. En
effet, il aspire à réaliser des projets contextualisés, des lieux de convivialité où s’invitent des
fantaisies, des prétextes à la « promenade architecturale » où les cinq sens sont convoqués.
Paradoxalement, les adeptes du Mouvement moderne qui prônaient la « tabula rasa », au nom
de la modernité, n’ont-ils pas adopté les mêmes principes ?
Most of Fernand Pouillon’s body of work is located in Algeria. Its huge production is made of
housing, hotels, city halls, movie theaters and more…his architectural work reflects a great
freedom of thinking. However he keeps following historical continuity. Such a process
promotes respect of place and enhances value of Mediterranean vernacular architecture.
We started with an assessment: the very bad quality of build environment. This reality is related
to the problem of Algerian architectural identity. Therefore we stated a hypothesis: the analysis
of Pouillon’s projects will teach us lessons of design. Then we will participate to a better
architectural production in the future.
This PhD thesis aims an identification of Pouillon’s composition principles.
Following the challenge: “building the most beautiful tourism program in Mediterranean sea”,
Pouillon designed (between 1965 and 1984) 40 hotels, kind of holidays villages. These are
making the body of our research. The morphological study will show up their design qualities
from site scale to details. The typological study will try to explain language diversity in plans:
contextual, distributive and stylistic.
Actually Pouillon used landscape for real sceneries where urban spaces were carefully
elaborated. Harmony between architecture and landscape: isn’t it a picturesque principle?
Excellent scholar, this architect loved being surrounded with artists and craftsmen who worked
in all his building sites. Wasn’t he, somehow a precursor of sustainable development?
Pouillon proposes architecture with multicultural references. He searches a new language for a
society in quest of identity.
At last, we will understand why and how Pouillon used picturesque approach. Actually, he
wishes to build contextualized and welcoming places for whims. These ideas are supports to
“architectural promenade”.
Paradoxically, Modern Movement followers valued the “tabula rasa” in the name of modernity.
Didn’t they choose the same principles?
Directeur de thèse : MEGHFOUR KACEMI Malika Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 1842 02-14-209 Version numérique et papier Bibliothèque USTOMB Thèse de Doctorat Exclu du prêt Documents numériques
02-14-209Adobe Acrobat PDFContribution à l'étude de l'éclairage naturel dans l'habitat collectif en Algérie:cas de la cité 865 logements Soumaa Blida / NADJI Ismahan

Titre : Contribution à l'étude de l'éclairage naturel dans l'habitat collectif en Algérie:cas de la cité 865 logements Soumaa Blida Type de document : texte imprimé Auteurs : NADJI Ismahan, Auteur Année de publication : 2019/2020 Accompagnement : CD Langues : Français (fre) Catégories : Architecture:Architecture Mots-clés : habitat collectif logement éclairage naturel post occupation méthode simulation d’éclairage confort visuel optimisation.
collective housing, apartment natural lighting post-occupancy method lighting simulation visual comfort, Optimization.Résumé : La présente étude vise à évaluer l'éclairage naturel dans les logements collectifs occupés dans le contexte de construction algérienne initié par l'Agence pour l'amélioration et le développement du logement (AADL). Elle vise aussi à analyser les facteurs susceptibles d’intervenir pour l’abaissement de la consommation d’énergie dans les logements collectifs, tout en soulignant le rôle de la conception architecturale dans l’atteinte du confort visuel. Pour réaliser cette évaluation post-occupation, une enquête et des mesures sur site ont été utilisées. L’enquête auprès des occupants confirme le manque d’éclairage naturel dans les logements et a permis de relever trois indicateurs influents : l’orientation, les masques et le niveau du logement. En vue d’une confrontation avec les résultats de l’enquête, une étude expérimentale basée sur des mesures in situ, a été investie pour évaluer le niveau d'éclairage naturel. Par ailleurs, le niveau d’éclairement naturel a été simulé en utilisant le logiciel de modélisation et d’animation 3DSMax où les données obtenues ont été traitées avec le logiciel Matlab. Cela nous a permis de comparer les niveaux d'éclairage entre expérience et simulation pour un échantillon de jours représentatifs d'une année à différentes heures et à différentes positions du soleil journalier. Une base de données a été formée avec 67032 points de mesure suffisants pour analyse globale d’éclairage naturel dans les logements. La méthodologie proposée dans le cadre de cette recherche permet de calculer le pourcentage de points entrant dans la zone de confort. Cela nous a permis de déceler les facteurs déterminants (orientation, niveau d’étage) et d’identifier les erreurs de conception (Masques, positions et taille des ouvertures), pour proposer des améliorations et de conclure en démontrant l'impact de la conception architecturale sur le niveau d’éclairage naturel. L'analyse des résultats montre l'effet des facteurs déterminants sur le confort visuel dans l’espace d'habitation et l'importance d'utiliser les simulations comme outils d'aide à la décision pour concevoir un logement confortable et énergétiquement économique.
The present study aims to evaluate natural lighting in the collective housing in the new Algerian building context initiated by the Agency for the Improvement and Development of Housing (AADL). It also aims to analyze the factors likely to intervene for the lowering of energy consumption in collective housing, while highlighting the role of architectural design in achieving visual comfort. To achieve this post-occupancy assessment, a survey and on-site measurements were used. The occupant survey confirms the lack of natural lighting in housing units and three influential indicators: orientation, masks and the level of housing. In order to confront the results of the survey, an experimental study based on in situ measurements was invested to evaluate the level of natural lighting. Furthermore, the level of natural lighting was simulated using 3DSMax modeling and animation software where the data obtained were processed with the Matlab software. This allowed us to compare the lighting levels between experiment and simulation for a sample of representative days of a year at different times and at different positions of the daily sun. A database was formed with 67032 measurement points sufficient for global analysis of natural lighting in housing. The methodology proposed in this research allows us to calculate the percentage of points entering the comfort zone, identify the determining factors (orientation, floor level) and design errors, to propose improvements and to conclude by demonstrating the impact of the architectural design on the level of natural lighting. The analysis of the results shows the effect of the determining factors on visual comfort in the living space and the importance of using simulations as decision-making tools to design a comfortable and energy-efficient housing.
Directeur de thèse : MOKHTARI Abderrahmane Contribution à l'étude de l'éclairage naturel dans l'habitat collectif en Algérie:cas de la cité 865 logements Soumaa Blida [texte imprimé] / NADJI Ismahan, Auteur . - 2019/2020 . - + CD.
Langues : Français (fre)
Catégories : Architecture:Architecture Mots-clés : habitat collectif logement éclairage naturel post occupation méthode simulation d’éclairage confort visuel optimisation.
collective housing, apartment natural lighting post-occupancy method lighting simulation visual comfort, Optimization.Résumé : La présente étude vise à évaluer l'éclairage naturel dans les logements collectifs occupés dans le contexte de construction algérienne initié par l'Agence pour l'amélioration et le développement du logement (AADL). Elle vise aussi à analyser les facteurs susceptibles d’intervenir pour l’abaissement de la consommation d’énergie dans les logements collectifs, tout en soulignant le rôle de la conception architecturale dans l’atteinte du confort visuel. Pour réaliser cette évaluation post-occupation, une enquête et des mesures sur site ont été utilisées. L’enquête auprès des occupants confirme le manque d’éclairage naturel dans les logements et a permis de relever trois indicateurs influents : l’orientation, les masques et le niveau du logement. En vue d’une confrontation avec les résultats de l’enquête, une étude expérimentale basée sur des mesures in situ, a été investie pour évaluer le niveau d'éclairage naturel. Par ailleurs, le niveau d’éclairement naturel a été simulé en utilisant le logiciel de modélisation et d’animation 3DSMax où les données obtenues ont été traitées avec le logiciel Matlab. Cela nous a permis de comparer les niveaux d'éclairage entre expérience et simulation pour un échantillon de jours représentatifs d'une année à différentes heures et à différentes positions du soleil journalier. Une base de données a été formée avec 67032 points de mesure suffisants pour analyse globale d’éclairage naturel dans les logements. La méthodologie proposée dans le cadre de cette recherche permet de calculer le pourcentage de points entrant dans la zone de confort. Cela nous a permis de déceler les facteurs déterminants (orientation, niveau d’étage) et d’identifier les erreurs de conception (Masques, positions et taille des ouvertures), pour proposer des améliorations et de conclure en démontrant l'impact de la conception architecturale sur le niveau d’éclairage naturel. L'analyse des résultats montre l'effet des facteurs déterminants sur le confort visuel dans l’espace d'habitation et l'importance d'utiliser les simulations comme outils d'aide à la décision pour concevoir un logement confortable et énergétiquement économique.
The present study aims to evaluate natural lighting in the collective housing in the new Algerian building context initiated by the Agency for the Improvement and Development of Housing (AADL). It also aims to analyze the factors likely to intervene for the lowering of energy consumption in collective housing, while highlighting the role of architectural design in achieving visual comfort. To achieve this post-occupancy assessment, a survey and on-site measurements were used. The occupant survey confirms the lack of natural lighting in housing units and three influential indicators: orientation, masks and the level of housing. In order to confront the results of the survey, an experimental study based on in situ measurements was invested to evaluate the level of natural lighting. Furthermore, the level of natural lighting was simulated using 3DSMax modeling and animation software where the data obtained were processed with the Matlab software. This allowed us to compare the lighting levels between experiment and simulation for a sample of representative days of a year at different times and at different positions of the daily sun. A database was formed with 67032 measurement points sufficient for global analysis of natural lighting in housing. The methodology proposed in this research allows us to calculate the percentage of points entering the comfort zone, identify the determining factors (orientation, floor level) and design errors, to propose improvements and to conclude by demonstrating the impact of the architectural design on the level of natural lighting. The analysis of the results shows the effect of the determining factors on visual comfort in the living space and the importance of using simulations as decision-making tools to design a comfortable and energy-efficient housing.
Directeur de thèse : MOKHTARI Abderrahmane Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 1749 02-14-204 Version numérique et papier Bibliothèque USTOMB Thèse de Doctorat Exclu du prêt Documents numériques
02-14-204.pdfAdobe Acrobat PDFL’espace Ksourien un champ de construction identitaire, économique et culturel. Cas des agglomérations des monts des ksour. / MEBARKI Abdelkhaliq
Titre : L’espace Ksourien un champ de construction identitaire, économique et culturel. Cas des agglomérations des monts des ksour. Type de document : texte imprimé Auteurs : MEBARKI Abdelkhaliq, Auteur Année de publication : 2020-2021 Importance : 225 p. Format : A4 Accompagnement : CD Langues : Français (fre) Catégories : Architecture:Architecture Mots-clés : Monts des ksour, Espace ksourien, Mutation, Rupture, Nouvelle extension,
société, Culture, Economie.Index. décimale : Architecture Résumé : Notre hypothèse de départ émanant d’un constat de changement dans la production de l’espace ksourien. Ces changements ont parfois un caractère de rupture totale avec l’ancien mode de production de cet espace, d’autre fois ils ont un caractère de mutation graduelle.
Pour étudier les différents facteurs et causes, une enquête a été menée auprès d’un échantillon représentant trois agglomérations ksouriennes, à l’Ouest de l’Atlas saharien (partie
algérienne). Les résultats de cette enquête ont démontré que :
- Les changements dans la production de l’espace ont touché le tissu traditionnel (intramuros), ainsi que la logique de construction externe (extra-muros).
- les trois agglomérations étudiées suivent le même cheminement, et la même logique d’évolution, avec un décalage de degré de changement.
- Ces changements sont dus principalement à des facteurs socio-économico-culturels, qui ont caractérisé la région pendant les dernières décennies, tels que :
1- La disparition progressive de la famille étendue.
2- Les modèles types imposés par l’administration.
3- Les changements d’activité économique, et la mobilité des personnes.
4- Le niveau d’instruction de la nouvelle génération
5- Tous les éléments socio-économico-culturels précédents poussent vers l’exode du ksar, sauf les lieux spirituels et de culte (la mosquée, la zaouïa, l’école coranique,….) qui jouent un rôle inverse, c'est-à-dire l’attachement au ksar.
Après analyse et discussions des résultats, cette étude a permis, de dégager deux sortes de recommandations, l’une d’ordre scientifique, et l’autre pratique.Directeur de thèse : MADANI Mohamed L’espace Ksourien un champ de construction identitaire, économique et culturel. Cas des agglomérations des monts des ksour. [texte imprimé] / MEBARKI Abdelkhaliq, Auteur . - 2020-2021 . - 225 p. ; A4 + CD.
Langues : Français (fre)
Catégories : Architecture:Architecture Mots-clés : Monts des ksour, Espace ksourien, Mutation, Rupture, Nouvelle extension,
société, Culture, Economie.Index. décimale : Architecture Résumé : Notre hypothèse de départ émanant d’un constat de changement dans la production de l’espace ksourien. Ces changements ont parfois un caractère de rupture totale avec l’ancien mode de production de cet espace, d’autre fois ils ont un caractère de mutation graduelle.
Pour étudier les différents facteurs et causes, une enquête a été menée auprès d’un échantillon représentant trois agglomérations ksouriennes, à l’Ouest de l’Atlas saharien (partie
algérienne). Les résultats de cette enquête ont démontré que :
- Les changements dans la production de l’espace ont touché le tissu traditionnel (intramuros), ainsi que la logique de construction externe (extra-muros).
- les trois agglomérations étudiées suivent le même cheminement, et la même logique d’évolution, avec un décalage de degré de changement.
- Ces changements sont dus principalement à des facteurs socio-économico-culturels, qui ont caractérisé la région pendant les dernières décennies, tels que :
1- La disparition progressive de la famille étendue.
2- Les modèles types imposés par l’administration.
3- Les changements d’activité économique, et la mobilité des personnes.
4- Le niveau d’instruction de la nouvelle génération
5- Tous les éléments socio-économico-culturels précédents poussent vers l’exode du ksar, sauf les lieux spirituels et de culte (la mosquée, la zaouïa, l’école coranique,….) qui jouent un rôle inverse, c'est-à-dire l’attachement au ksar.
Après analyse et discussions des résultats, cette étude a permis, de dégager deux sortes de recommandations, l’une d’ordre scientifique, et l’autre pratique.Directeur de thèse : MADANI Mohamed Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire
Titre : Espace de la mort et fondation des cités Type de document : texte imprimé Auteurs : DJERADI Mustapha Ameur, Auteur Année de publication : 2020-2021 Accompagnement : CD Langues : Français (fre) Catégories : Architecture:Architecture Mots-clés : Cité Espace de la mort fondation Ĝşar sacré Walî
City Ĝşar foundation sacred Space of death Walî.Résumé : Le mort est une entité qui existe, à laquelle on rend visite et qui garde sa place parmi les vivants. Cette existence du mort induit l'existence d'un espace de la mort. Notre question est : Quelle est la place et le rôle de la mort dans la fondation des cités ? À contre-courant de l’évidence établie, la genèse des cités prend racines dans un vécu "spirituel" lié à la mort. L’objectif est de montrer de quelle manière l’organisation de l’espace habité d’ici-bas est liée à la mort et ses représentations.
A travers une vision rétrospective, je perçus la place du cimetière et saisis sa typologie. À partir de cette vision rétrospective et par l’approche axiologique, je posai les prémices d’une vision prospectives de l’espace de la mort. L’idée à retenir fut de traiter le cimetière entant que "seuil Urbain". Pour les logiques fondatrices, elles sont ancrées dans la mémoire collective et évoquées par les récits hagiographiques. Je captai cinq facteurs de fondation. Le premier facteur est la violence et ses représentations. J’insistai sur l’impact de la violence sur la configuration spatiale de l’espace ĝşûrien. Le deuxième est la mort, la tombe est la première demeure fixe de l’homme. La cité fut d'abord un lieu de rencontre autour et pour le mort. Le troisième facteur est la fête. Celle-ci régénère le ĝşar. Au moment de la fête, on rejoue la fondation telle que cela s'est passé. Au quatrième plan c’est la parole oraculaire. Le fondateur, s’en alla créer un autre ĝşar, sous l’impulsion d’une parole venue d’un Maître ou d’un anonyme. Au cinquième plan l'errance. Un territoire peuplé eut toujours un patron. Ce furent ces pérégrinations qui construisirent le lieu. Ces ermitages balisèrent et structurèrent le territoire. Ces cités qu’on considère comme le produit d'une spontanéité se révèlent être le produit d'une planification rigoureuse et plus complexe que la planification techniciste, en ce sens où elle a pris en compte non seulement le factuel mais encore et surtout l’immatériel : le sacré.
The dead person is an entity that exists, to which we visit and which keeps its
place among the living. This existence of the dead induces the existence of a space of
death. Our question is: What is the place and role of death in the foundation of
cities? Against the tide of established evidence, the genesis of cities takes root in a
"spiritual" experience linked to death. The objective is to show how the organization
of the inhabited space here below is linked to death and its representations.
Through a retrospective vision, we perceived the place of the cemetery and
understood its typology. From this retrospective view and through the axiological
approach, we have laid the groundwork for a prospective view of the space of death.
The idea to remember is to treat the cemetery as an "Urban threshold". For the
founding logics, they are anchored in the collective memory and evoked by
hagiographic accounts. We have captured five foundational factors. The first factor is
violence and its representations. We have insisted on the impact of violence on the
spatial configuration of the ĝşûrien space. The second is death; we have understood
that the grave is the first fixed abode of man. The city was first of all a meeting place
around and for the dead. The third factor is the party. This regenerates the ĝşar. At
the time of the feast, we replay the foundation as it happened. In the fourth level is
the oracular speech. The founder was going to create another ĝşar, under the impetus
of a word from a Master or an anonymous person. In the fifth plan, wandering. A
populated territory always had a boss. It is these peregrinations that built the place.
These hermitages marked out and structured the territory.
These cities that we see as the product of spontaneity turn out to be the
product of rigorous planning and more complex than technical planning, in the sense
that it has taken into account not only the factual but also and above all the
intangible: the sacred.
Directeur de thèse : BENKOULA Sidi mohamed El Habib Espace de la mort et fondation des cités [texte imprimé] / DJERADI Mustapha Ameur, Auteur . - 2020-2021 . - + CD.
Langues : Français (fre)
Catégories : Architecture:Architecture Mots-clés : Cité Espace de la mort fondation Ĝşar sacré Walî
City Ĝşar foundation sacred Space of death Walî.Résumé : Le mort est une entité qui existe, à laquelle on rend visite et qui garde sa place parmi les vivants. Cette existence du mort induit l'existence d'un espace de la mort. Notre question est : Quelle est la place et le rôle de la mort dans la fondation des cités ? À contre-courant de l’évidence établie, la genèse des cités prend racines dans un vécu "spirituel" lié à la mort. L’objectif est de montrer de quelle manière l’organisation de l’espace habité d’ici-bas est liée à la mort et ses représentations.
A travers une vision rétrospective, je perçus la place du cimetière et saisis sa typologie. À partir de cette vision rétrospective et par l’approche axiologique, je posai les prémices d’une vision prospectives de l’espace de la mort. L’idée à retenir fut de traiter le cimetière entant que "seuil Urbain". Pour les logiques fondatrices, elles sont ancrées dans la mémoire collective et évoquées par les récits hagiographiques. Je captai cinq facteurs de fondation. Le premier facteur est la violence et ses représentations. J’insistai sur l’impact de la violence sur la configuration spatiale de l’espace ĝşûrien. Le deuxième est la mort, la tombe est la première demeure fixe de l’homme. La cité fut d'abord un lieu de rencontre autour et pour le mort. Le troisième facteur est la fête. Celle-ci régénère le ĝşar. Au moment de la fête, on rejoue la fondation telle que cela s'est passé. Au quatrième plan c’est la parole oraculaire. Le fondateur, s’en alla créer un autre ĝşar, sous l’impulsion d’une parole venue d’un Maître ou d’un anonyme. Au cinquième plan l'errance. Un territoire peuplé eut toujours un patron. Ce furent ces pérégrinations qui construisirent le lieu. Ces ermitages balisèrent et structurèrent le territoire. Ces cités qu’on considère comme le produit d'une spontanéité se révèlent être le produit d'une planification rigoureuse et plus complexe que la planification techniciste, en ce sens où elle a pris en compte non seulement le factuel mais encore et surtout l’immatériel : le sacré.
The dead person is an entity that exists, to which we visit and which keeps its
place among the living. This existence of the dead induces the existence of a space of
death. Our question is: What is the place and role of death in the foundation of
cities? Against the tide of established evidence, the genesis of cities takes root in a
"spiritual" experience linked to death. The objective is to show how the organization
of the inhabited space here below is linked to death and its representations.
Through a retrospective vision, we perceived the place of the cemetery and
understood its typology. From this retrospective view and through the axiological
approach, we have laid the groundwork for a prospective view of the space of death.
The idea to remember is to treat the cemetery as an "Urban threshold". For the
founding logics, they are anchored in the collective memory and evoked by
hagiographic accounts. We have captured five foundational factors. The first factor is
violence and its representations. We have insisted on the impact of violence on the
spatial configuration of the ĝşûrien space. The second is death; we have understood
that the grave is the first fixed abode of man. The city was first of all a meeting place
around and for the dead. The third factor is the party. This regenerates the ĝşar. At
the time of the feast, we replay the foundation as it happened. In the fourth level is
the oracular speech. The founder was going to create another ĝşar, under the impetus
of a word from a Master or an anonymous person. In the fifth plan, wandering. A
populated territory always had a boss. It is these peregrinations that built the place.
These hermitages marked out and structured the territory.
These cities that we see as the product of spontaneity turn out to be the
product of rigorous planning and more complex than technical planning, in the sense
that it has taken into account not only the factual but also and above all the
intangible: the sacred.
Directeur de thèse : BENKOULA Sidi mohamed El Habib Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 1851 02-14-207 Version numérique et papier Bibliothèque USTOMB Thèse de Doctorat Exclu du prêt Documents numériques
02-14-207.pdfAdobe Acrobat PDF
Titre : Espaces publics urbains : les limites réelles des rues. Le cas de la ville de Bechar Type de document : texte imprimé Auteurs : KADRI Soraya, Auteur Année de publication : 2020-2021 Accompagnement : CD Langues : Français (fre) Catégories : Architecture:Architecture Mots-clés : Limites, Espaces publics urbains, Rues, Sahara, Oasis, Ville, Transgression.
Boundaries, Urban public spaces, Streets, Sahara, Oasis, City, Transgression.Résumé : D’une évidence indéniable, les limites sont indissociables du système formel qu'ils enveloppent, et sont destinées à restreindre la profondeur et l'infini. Dans les oasis sahariennes, le système formel est parfaitement unitaire et homogène. Il définit une relation harmonieuse avec l'environnement naturel qui le limite. La limite de ce dernier constitue une sorte de familiarité, signe de la reconnaissance de l'environnement.
D’abord la frontière faite par le rempart de l'espace habité est l'une des bases primordiales de la grammaire des sociétés sahariennes pour fixer des limites de l'extérieur. Ensuite les limites des rues, dans la mesure où elles divisent les entités habitables, s'avèrent être les structures de raccordement; puisqu’à la fois elles arrêtent, et laissent passer, selon le code sociétal.
Ainsi, le paradoxe de la limite des rues, malgré son rôle comme barrière par le jeu de la lumière et l'obscurité, par l'étroitesse de sa dimension, par la sinuosité de son agencement... elle reste transitoire.
Dans la culture de l'oasis, la perception de la rue comme une frontière entre l'intérieur et l'extérieur, garantit l'intimité de l'espace habité (seuil à ne pas dépasser), s'estompe à présent dans la ville « européanisée », et s'ouvre à tous. Et ce en réponse à un urbanisme importé d'ailleurs où la construction d'interminables limites telles que les clôtures de résidences dont l'objectif simpliste est de séparer les espaces.
Si l'oasien a vécu une vie rationnelle dans la mesure où il comprenait les composantes de son espace et ses limites, il n’en est pas de même aujourd'hui. De l'oasis à la ville, dans cet espace urbanisé, l'étendue du décalage entre l'image qu’offre l'ancienne organisation spatiale (qui reflète l'image réelle quotidienne de ceux que nous appelons les Sahariens), ainsi que le théâtre de croissance actuelle (qui importe ses modèles des pays occidentaux, loin de s'adapter au contexte saharien), est tout à fait détectable. Ces dynamiques spatiales témoignent de transmutations pertinentes qui s’opèrent sur les habitations au Sahara (typiquement à Bechar sélectionnée comme cas d’étude), mais aussi sur les espaces publics urbains : les rues précisément, autant sur le plan formel que sur les pratiques intrinsèques.
Par conséquent, il est nécessaire aujourd'hui de s'interroger sur les lignes de démarcation des rues héritées, dont la façon de tracer des frontières claires, et l'art de déjouer le vent et le soleil se sont estompés. Actuellement, ces limites suivent rarement un tracé linéaire pour permettre de discerner deux étendues. À première vue, elles alternent, corrompent, et s'emmêlent donnant naissance à des métaphores. D'où la difficulté à construire, de manière lisible les espaces de rues. En effet, si la limite des rues est supposée entrain de disparaitre, cela peut être probablement dû aux actes et agis individuels qui n’assouvissent plus la réflexion globale, empiétant davantage sur la propriété publique. Cela est agrémenté par l’absence d’une planification préalable et des services de contrôle territorialement compétant.
Pour vérifier cette hypothèse, cette étude descriptive et explicative des symptomatiques des limites des rues à Bechar passe par une lecture historique agrémentée par une approche diachronique ainsi qu’une enquête sociologique.
It is undeniably obvious that limits are inseparable from the formal system they encompass, and are intended to restrict depth and infinity. In the Saharan oases, the formal system is perfectly unified and homogeneous. It defines a harmonious relationship with the natural environment that limits it. The limit of the latter constitutes a kind of familiarity, friendliness, the sign of recognition of the environment.
First of all, the boundary created by the rampart of the inhabited space is one of the essential bases of the grammar of Saharan societies to set boundaries from the outside. Then the limits of the streets, insofar as they divide the habitable entities, turn out to be the connecting structures; since they both stop, and let pass, according to the societal code.
Thus, the paradox of the street limit, despite its role as a barrier through the play of light and darkness, through the narrowness of its dimension, through the sinuosity of its arrangement... it remains transitory.
In the culture of the oasis, the perception of the street as a border between the interior and the exterior, guarantees the intimacy of the inhabited space (threshold not to be exceeded), now fades into the Europeanized city, and opens up to all. And this in response to imported urban planning where the construction of endless limits such as residential fences whose simplistic objective is to separate spaces.
If the oasis has lived a rational life insofar as he understood the components of his Space and its limits, it is not the same today. From the oasis to the city, in this urbanized space, the extent of the gap between the image offered by the old spatial organization (which reflects the real daily image of those we call Saharians), as well as the current growth theatre (which imports its models from Western countries, far from adapting to the Saharan context), is quite detectable. These spatial dynamics testify to the relevant transmutations that take place on dwellings in the Sahara (typically in Bechar selected as case studies), but also on public spaces
Urban: the streets precisely, both formally and in terms of intrinsic practices.
Therefore, it is necessary today to question the demarcation lines of inherited streets, including how to draw clear borders, how to thwart the wind and sun have faded. Currently, these boundaries rarely follow a linear line to allow two areas to be identified. At first glance, they alternate, corrupt, and become entangled, giving rise to metaphors. Hence the difficulty of building street spaces in a legible way. This is supposed to be the responsibility of If the street line is supposed to disappear, it can probably be due to individual actions and actions that no longer satisfy global thinking, encroaching more on public property. It is enhanced by the absence of prior planning and territorially competent control services.
To verify this hypothesis, this descriptive and explanatory study of the symptoms of street boundaries in Bechar involves a historical reading enhanced by a diachronic approach as well as a sociological investigation.
Directeur de thèse : MEGHFOUR KACEMI Malika Espaces publics urbains : les limites réelles des rues. Le cas de la ville de Bechar [texte imprimé] / KADRI Soraya, Auteur . - 2020-2021 . - + CD.
Langues : Français (fre)
Catégories : Architecture:Architecture Mots-clés : Limites, Espaces publics urbains, Rues, Sahara, Oasis, Ville, Transgression.
Boundaries, Urban public spaces, Streets, Sahara, Oasis, City, Transgression.Résumé : D’une évidence indéniable, les limites sont indissociables du système formel qu'ils enveloppent, et sont destinées à restreindre la profondeur et l'infini. Dans les oasis sahariennes, le système formel est parfaitement unitaire et homogène. Il définit une relation harmonieuse avec l'environnement naturel qui le limite. La limite de ce dernier constitue une sorte de familiarité, signe de la reconnaissance de l'environnement.
D’abord la frontière faite par le rempart de l'espace habité est l'une des bases primordiales de la grammaire des sociétés sahariennes pour fixer des limites de l'extérieur. Ensuite les limites des rues, dans la mesure où elles divisent les entités habitables, s'avèrent être les structures de raccordement; puisqu’à la fois elles arrêtent, et laissent passer, selon le code sociétal.
Ainsi, le paradoxe de la limite des rues, malgré son rôle comme barrière par le jeu de la lumière et l'obscurité, par l'étroitesse de sa dimension, par la sinuosité de son agencement... elle reste transitoire.
Dans la culture de l'oasis, la perception de la rue comme une frontière entre l'intérieur et l'extérieur, garantit l'intimité de l'espace habité (seuil à ne pas dépasser), s'estompe à présent dans la ville « européanisée », et s'ouvre à tous. Et ce en réponse à un urbanisme importé d'ailleurs où la construction d'interminables limites telles que les clôtures de résidences dont l'objectif simpliste est de séparer les espaces.
Si l'oasien a vécu une vie rationnelle dans la mesure où il comprenait les composantes de son espace et ses limites, il n’en est pas de même aujourd'hui. De l'oasis à la ville, dans cet espace urbanisé, l'étendue du décalage entre l'image qu’offre l'ancienne organisation spatiale (qui reflète l'image réelle quotidienne de ceux que nous appelons les Sahariens), ainsi que le théâtre de croissance actuelle (qui importe ses modèles des pays occidentaux, loin de s'adapter au contexte saharien), est tout à fait détectable. Ces dynamiques spatiales témoignent de transmutations pertinentes qui s’opèrent sur les habitations au Sahara (typiquement à Bechar sélectionnée comme cas d’étude), mais aussi sur les espaces publics urbains : les rues précisément, autant sur le plan formel que sur les pratiques intrinsèques.
Par conséquent, il est nécessaire aujourd'hui de s'interroger sur les lignes de démarcation des rues héritées, dont la façon de tracer des frontières claires, et l'art de déjouer le vent et le soleil se sont estompés. Actuellement, ces limites suivent rarement un tracé linéaire pour permettre de discerner deux étendues. À première vue, elles alternent, corrompent, et s'emmêlent donnant naissance à des métaphores. D'où la difficulté à construire, de manière lisible les espaces de rues. En effet, si la limite des rues est supposée entrain de disparaitre, cela peut être probablement dû aux actes et agis individuels qui n’assouvissent plus la réflexion globale, empiétant davantage sur la propriété publique. Cela est agrémenté par l’absence d’une planification préalable et des services de contrôle territorialement compétant.
Pour vérifier cette hypothèse, cette étude descriptive et explicative des symptomatiques des limites des rues à Bechar passe par une lecture historique agrémentée par une approche diachronique ainsi qu’une enquête sociologique.
It is undeniably obvious that limits are inseparable from the formal system they encompass, and are intended to restrict depth and infinity. In the Saharan oases, the formal system is perfectly unified and homogeneous. It defines a harmonious relationship with the natural environment that limits it. The limit of the latter constitutes a kind of familiarity, friendliness, the sign of recognition of the environment.
First of all, the boundary created by the rampart of the inhabited space is one of the essential bases of the grammar of Saharan societies to set boundaries from the outside. Then the limits of the streets, insofar as they divide the habitable entities, turn out to be the connecting structures; since they both stop, and let pass, according to the societal code.
Thus, the paradox of the street limit, despite its role as a barrier through the play of light and darkness, through the narrowness of its dimension, through the sinuosity of its arrangement... it remains transitory.
In the culture of the oasis, the perception of the street as a border between the interior and the exterior, guarantees the intimacy of the inhabited space (threshold not to be exceeded), now fades into the Europeanized city, and opens up to all. And this in response to imported urban planning where the construction of endless limits such as residential fences whose simplistic objective is to separate spaces.
If the oasis has lived a rational life insofar as he understood the components of his Space and its limits, it is not the same today. From the oasis to the city, in this urbanized space, the extent of the gap between the image offered by the old spatial organization (which reflects the real daily image of those we call Saharians), as well as the current growth theatre (which imports its models from Western countries, far from adapting to the Saharan context), is quite detectable. These spatial dynamics testify to the relevant transmutations that take place on dwellings in the Sahara (typically in Bechar selected as case studies), but also on public spaces
Urban: the streets precisely, both formally and in terms of intrinsic practices.
Therefore, it is necessary today to question the demarcation lines of inherited streets, including how to draw clear borders, how to thwart the wind and sun have faded. Currently, these boundaries rarely follow a linear line to allow two areas to be identified. At first glance, they alternate, corrupt, and become entangled, giving rise to metaphors. Hence the difficulty of building street spaces in a legible way. This is supposed to be the responsibility of If the street line is supposed to disappear, it can probably be due to individual actions and actions that no longer satisfy global thinking, encroaching more on public property. It is enhanced by the absence of prior planning and territorially competent control services.
To verify this hypothesis, this descriptive and explanatory study of the symptoms of street boundaries in Bechar involves a historical reading enhanced by a diachronic approach as well as a sociological investigation.
Directeur de thèse : MEGHFOUR KACEMI Malika Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 1806 02-14-206 Version numérique et papier Bibliothèque USTOMB Thèse de Doctorat Exclu du prêt Documents numériques
02-14-206.pdfAdobe Acrobat PDFEVOLUTION DE L’HERITAGE COLONIAL BATI ENTRE DEUX CULTURES : IDENTITE CULTURELLE, ACTEURS ET RECONNAISSANCE PATRIMONIALE. Cas des logements sociaux à Oran entre 1945 et 1958 / KARA MOSTEFA Loubna

PermalinkEvolution des modèles conceptuels des espaces de travail (bureaux) ; entre optimisation du confort et hégémonie de l’image : le cas de la ville d’Oran / BENAMMAR Abdelkrim

PermalinkLes permanences des ksour dans la production des tissus vernaculaires. Le cas de Béni-Abbès. / LAYACHI Abdeldjebar

PermalinkPermalinkLa question de l' insertion des mosquées dans les ville non musulmanes en europe à travers le cas infuent de la france / Sidi mohammed el habib BENKOULA
Permalink
BUC USTOMB'Thèses

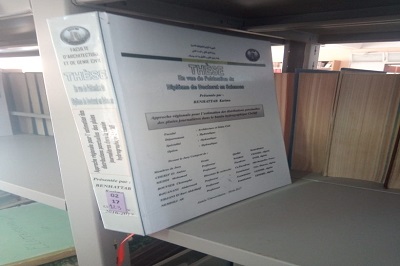

Service Thèse de la BUC met à votre disposition L'ensemble des thèses de doctorat et mémoires de magister soutenues à l'USTO MB
Adresse
BUC USTOMB'ThèsesBibliothèque centrale USTOMB
BP 1505 EL M'Naouer USTO ORAN
Algérie
(213)041627180
contact