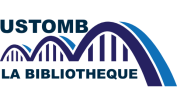les Thèses Soutenues à l'USTO MB
vous cherchez une thèse?
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les recherches... | Votre compte |
Catégories


 Faire une suggestion Affiner la recherche
Faire une suggestion Affiner la rechercheCaractérisation génétique de quatre populations bovines algériennes sur la puce Illumina BovineSNP54K et étude de leurs relations phylogénétiques / BOUSHABA Nadjet
Titre : Caractérisation génétique de quatre populations bovines algériennes sur la puce Illumina BovineSNP54K et étude de leurs relations phylogénétiques Type de document : document électronique Auteurs : BOUSHABA Nadjet, Auteur Année de publication : 2018-2019 Accompagnement : CD Langues : Français (fre) Catégories : biologie moléculaire Mots-clés : Diversité génétique - Phylogénie - Population bovine - SNP - Structure génétique. Résumé : Traditionnellement, la classification des populations bovines algériennes appartenant à la race "Brune de l’Atlas" a été basée sur des caractères phénotypiques visibles et les traits productifs. Elles représentent une ressource animale importante en termes de diversité génétique et de pertinence socio-économique. En effet, les importations et les croisements incontrôlés se sont accentués et risquent de mener à une érosion de la diversité génétique des populations bovines sur l'ensemble de l'aire de distribution de l'espèce. Leur caractérisation génétique en utilisant des marqueurs de type SNP (Simple Nucleotide Polymorphism) a été rendue possible dans le cadre du projet GALIMED (Genetic Adaptation of bovine LIvestock and production systems in MEDiterranean region). L’objectif de cette étude est de réaliser des enquêtes de terrain afin d’identifier les localisations géographiques de quatre (04) populations bovines locales au niveau du territoire national et d’analyser leur diversité génétique. Au total, 121 animaux non apparentés ont été génotypés avec un panel de 50,309 marqueurs SNP autosomiques sur la puce Illumina BovineSNP54K et les résultats obtenus ont été combinés avec ceux disponibles sur 37 autres populations représentatives de bovins africains, européens et races de zébu.
Les résultats de nos prospections nous ont permis de prélever 142 échantillons de sang d’animaux : Biskra (BIS, n = 40) ; Cheurfa (CHE, n = 31) ; Chelifienne (CHF, n = 40) et Guelmoise (GUE, n = 31). L’extraction d’ADN a été réalisée avec le kit STRATAGENE. Les ADN extraits ont été dosés par spectrophotomètre à 260 et à 280nm et leur qualité a été vérifiée par électrophorèse sur gel d’agarose à 0.8%.
Les résultats statistiques obtenus des valeurs moyennes du taux d’hétérozygotie (He = 0,32) confirment que les populations bovines étudiées présentent une grande diversité génétique. Les individus ont présenté un indice beaucoup plus faible (FIS = 0,2), reflétant un faible niveau de consanguinité. L’Analyse en Composantes Principales explique seulement 9,80% de la variation totale. Le regroupement des deux populations CHE et GUE confirme leur origine commune. Les deux populations CHF et BIS sont caractérisées par une forte relation génétique avec les races européennes. La structure de la population a été évaluée à l'aide d'un regroupement basé sur un modèle (ADMIXTURE). A K = 3, les algorithmes bayésiens ont attribué tous les individus aux trois principales ascendances africaines, européennes et zébu. La faible estimation de l’indice (FST) entre les populations indique que le degré de différenciation génétique est faible, suggérant un niveau élevé de flux génétique. L’arbre phylogénétique de Neighbor-Joining construit en utilisant des distances d’allèles partagés entre individus a clairement différencié les populations bovines en fonction de leur origine historique et a confirmé que la population BIS est génétiquement distincte.
Nos résultats représentent la première étude fournissant des preuves génétiques sur l'origine et l'histoire du bovin local algérien.
En perspectives, il serait important de poursuivre ces travaux sur d’autres populations de bovins avec la même stratégie de génotypage pour une meilleure connaissance des ressources génétiques bovines. Les informations fournies par la caractérisation génétique à haut débit de notre étude permettront d’envisager à moyen terme, des méthodes de préservation et de conservation de ces populations bovines locales. A long terme, une amélioration par la sélection des animaux les plus performants pour des caractères zootechniques importants, pourrait être envisagée.
Directeur de thèse : TABET-AOUL Nacéra Caractérisation génétique de quatre populations bovines algériennes sur la puce Illumina BovineSNP54K et étude de leurs relations phylogénétiques [document électronique] / BOUSHABA Nadjet, Auteur . - 2018-2019 . - + CD.
Langues : Français (fre)
Catégories : biologie moléculaire Mots-clés : Diversité génétique - Phylogénie - Population bovine - SNP - Structure génétique. Résumé : Traditionnellement, la classification des populations bovines algériennes appartenant à la race "Brune de l’Atlas" a été basée sur des caractères phénotypiques visibles et les traits productifs. Elles représentent une ressource animale importante en termes de diversité génétique et de pertinence socio-économique. En effet, les importations et les croisements incontrôlés se sont accentués et risquent de mener à une érosion de la diversité génétique des populations bovines sur l'ensemble de l'aire de distribution de l'espèce. Leur caractérisation génétique en utilisant des marqueurs de type SNP (Simple Nucleotide Polymorphism) a été rendue possible dans le cadre du projet GALIMED (Genetic Adaptation of bovine LIvestock and production systems in MEDiterranean region). L’objectif de cette étude est de réaliser des enquêtes de terrain afin d’identifier les localisations géographiques de quatre (04) populations bovines locales au niveau du territoire national et d’analyser leur diversité génétique. Au total, 121 animaux non apparentés ont été génotypés avec un panel de 50,309 marqueurs SNP autosomiques sur la puce Illumina BovineSNP54K et les résultats obtenus ont été combinés avec ceux disponibles sur 37 autres populations représentatives de bovins africains, européens et races de zébu.
Les résultats de nos prospections nous ont permis de prélever 142 échantillons de sang d’animaux : Biskra (BIS, n = 40) ; Cheurfa (CHE, n = 31) ; Chelifienne (CHF, n = 40) et Guelmoise (GUE, n = 31). L’extraction d’ADN a été réalisée avec le kit STRATAGENE. Les ADN extraits ont été dosés par spectrophotomètre à 260 et à 280nm et leur qualité a été vérifiée par électrophorèse sur gel d’agarose à 0.8%.
Les résultats statistiques obtenus des valeurs moyennes du taux d’hétérozygotie (He = 0,32) confirment que les populations bovines étudiées présentent une grande diversité génétique. Les individus ont présenté un indice beaucoup plus faible (FIS = 0,2), reflétant un faible niveau de consanguinité. L’Analyse en Composantes Principales explique seulement 9,80% de la variation totale. Le regroupement des deux populations CHE et GUE confirme leur origine commune. Les deux populations CHF et BIS sont caractérisées par une forte relation génétique avec les races européennes. La structure de la population a été évaluée à l'aide d'un regroupement basé sur un modèle (ADMIXTURE). A K = 3, les algorithmes bayésiens ont attribué tous les individus aux trois principales ascendances africaines, européennes et zébu. La faible estimation de l’indice (FST) entre les populations indique que le degré de différenciation génétique est faible, suggérant un niveau élevé de flux génétique. L’arbre phylogénétique de Neighbor-Joining construit en utilisant des distances d’allèles partagés entre individus a clairement différencié les populations bovines en fonction de leur origine historique et a confirmé que la population BIS est génétiquement distincte.
Nos résultats représentent la première étude fournissant des preuves génétiques sur l'origine et l'histoire du bovin local algérien.
En perspectives, il serait important de poursuivre ces travaux sur d’autres populations de bovins avec la même stratégie de génotypage pour une meilleure connaissance des ressources génétiques bovines. Les informations fournies par la caractérisation génétique à haut débit de notre étude permettront d’envisager à moyen terme, des méthodes de préservation et de conservation de ces populations bovines locales. A long terme, une amélioration par la sélection des animaux les plus performants pour des caractères zootechniques importants, pourrait être envisagée.
Directeur de thèse : TABET-AOUL Nacéra Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 1607 02-34-111 Version numérique et papier Bibliothèque USTOMB Thèse de Doctorat Exclu du prêt Contribution au développement de la dosimétrie biologique en Algérie par les méthodes de cytogénétique / MESSAL DJELTI Ahlem Nora

Titre : Contribution au développement de la dosimétrie biologique en Algérie par les méthodes de cytogénétique Type de document : document électronique Auteurs : MESSAL DJELTI Ahlem Nora, Auteur Année de publication : 2017-2018 Accompagnement : CD Langues : Français (fre) Catégories : biologie moléculaire Mots-clés : Dosimétrie biologique, chromosome dicentrique, cytogénétique, courbe, PCC, dose/ effet, rayonnements γ, Colcemid, Calyculine-A. Résumé : L’évolution de la demande mondiale en énergie fera que l’Algérie développera dans un futur proche l’énergie nucléaire, ce qui nécessitera une compétence dans ce domaine et notamment dans l’évaluation de l’effet des RI émis en cas d’accidents.
La dosimétrie biologique est donc nécessaire aussi bien dans des cas d'exposition accidentelle, à de basses doses pour déterminer s'il y a eu exposition, qu’à des doses importantes pour aider à la mise en place un protocole adéquat, afin d’avoir une prise en charge thérapeutique pour les sujet irradiés.
Actuellement, la méthode admise, et la plus fiable de dosimétrie biologique, est l'analyse des modifications chromosomiques radio-induites, particulièrement la présence des chromosomes dicentriques dans des lymphocytes de sang périphérique par des méthodes de cytogénétique.
Dans le cadre de cette étude, nous avons établi, d’une part, une courbe de calibrage dose/effet, par la méthode de cytogénétique conventionnelle. D’une autre part nous avons déterminé par la technique de condensation prématurée des chromosomes (PCC), si la Calyculine-A a un effet sur le rendement des chromosomes dicentriques, observée dans les cellules en métaphase.
Les conditions expérimentales choisies pour réaliser la courbe de calibrage dose/ effet sont les mêmes que celles utilisées par l’équipe de Barquinero, laboratoire d’anthropologie, biologie végétale et écologie, (UAB), Espagne. La courbe de calibrage dose/ effet, était réalisée à partir d’un prélèvement sanguin d’une personne d’origine algérienne, supposée être saine et sans antécédents à une exposition aux RI. Les prélèvements ont été irradiés à 9 différentes doses de rayonnements γ et cultivés pendant 48 heures.
Nos résultats ont montrés que la courbe de calibrage dose/effet obtenue à partir de l’analyse des chromosomes dicentriques, obéit au modèle linéaire quadratique et la relation dose/effet s’exprime par l’équation Y = c + α D + β D² permettant ainsi d’estimer la dose d'une surexposition possible.
Pour la réalisation de l’étude en PCC, les échantillons de sang périphérique provenant d’une personne d’origine espagnole, ont été irradiés à 3 différentes doses 1 ; 4 et 10 Gy de rayonnements γ et cultivés pendant 48 heures. Le Colcemid a été ajouté soit 24 h, soit 2 h avant la récolte et aussi la moitié des cultures, ont également été traitées par la Calyculine-A à la dernière heure.
Concernant l’étude en PCC, pour les trois doses, les proportions de cellules M étaient plus élevées pour 24 heures avant la récolte, en présence de Colcemid seul, plus de celles à 2h avant la fin de la culture. Pa railleur, lorsque les fréquences des chromosomes dicentriques ont été comparées, aucunes différences a été trouvée entre les cultures où seul le Colcemid était utilisé et celles où le traitement par Calyculine-A était également incorporé.
Les présents résultats et la maitrise des techniques de cytogénétique utilisées en biodosimétrie, nous permettront d’envisager et de mettre en place un laboratoire de biodosimétrie sous forme d’une antenne au sein de LGMC, Université USTO, qui serait une référence à l’échelle nord-africaine et reconnu par les instances internationales
Directeur de thèse : BOUDJEMA Abdellah Contribution au développement de la dosimétrie biologique en Algérie par les méthodes de cytogénétique [document électronique] / MESSAL DJELTI Ahlem Nora, Auteur . - 2017-2018 . - + CD.
Langues : Français (fre)
Catégories : biologie moléculaire Mots-clés : Dosimétrie biologique, chromosome dicentrique, cytogénétique, courbe, PCC, dose/ effet, rayonnements γ, Colcemid, Calyculine-A. Résumé : L’évolution de la demande mondiale en énergie fera que l’Algérie développera dans un futur proche l’énergie nucléaire, ce qui nécessitera une compétence dans ce domaine et notamment dans l’évaluation de l’effet des RI émis en cas d’accidents.
La dosimétrie biologique est donc nécessaire aussi bien dans des cas d'exposition accidentelle, à de basses doses pour déterminer s'il y a eu exposition, qu’à des doses importantes pour aider à la mise en place un protocole adéquat, afin d’avoir une prise en charge thérapeutique pour les sujet irradiés.
Actuellement, la méthode admise, et la plus fiable de dosimétrie biologique, est l'analyse des modifications chromosomiques radio-induites, particulièrement la présence des chromosomes dicentriques dans des lymphocytes de sang périphérique par des méthodes de cytogénétique.
Dans le cadre de cette étude, nous avons établi, d’une part, une courbe de calibrage dose/effet, par la méthode de cytogénétique conventionnelle. D’une autre part nous avons déterminé par la technique de condensation prématurée des chromosomes (PCC), si la Calyculine-A a un effet sur le rendement des chromosomes dicentriques, observée dans les cellules en métaphase.
Les conditions expérimentales choisies pour réaliser la courbe de calibrage dose/ effet sont les mêmes que celles utilisées par l’équipe de Barquinero, laboratoire d’anthropologie, biologie végétale et écologie, (UAB), Espagne. La courbe de calibrage dose/ effet, était réalisée à partir d’un prélèvement sanguin d’une personne d’origine algérienne, supposée être saine et sans antécédents à une exposition aux RI. Les prélèvements ont été irradiés à 9 différentes doses de rayonnements γ et cultivés pendant 48 heures.
Nos résultats ont montrés que la courbe de calibrage dose/effet obtenue à partir de l’analyse des chromosomes dicentriques, obéit au modèle linéaire quadratique et la relation dose/effet s’exprime par l’équation Y = c + α D + β D² permettant ainsi d’estimer la dose d'une surexposition possible.
Pour la réalisation de l’étude en PCC, les échantillons de sang périphérique provenant d’une personne d’origine espagnole, ont été irradiés à 3 différentes doses 1 ; 4 et 10 Gy de rayonnements γ et cultivés pendant 48 heures. Le Colcemid a été ajouté soit 24 h, soit 2 h avant la récolte et aussi la moitié des cultures, ont également été traitées par la Calyculine-A à la dernière heure.
Concernant l’étude en PCC, pour les trois doses, les proportions de cellules M étaient plus élevées pour 24 heures avant la récolte, en présence de Colcemid seul, plus de celles à 2h avant la fin de la culture. Pa railleur, lorsque les fréquences des chromosomes dicentriques ont été comparées, aucunes différences a été trouvée entre les cultures où seul le Colcemid était utilisé et celles où le traitement par Calyculine-A était également incorporé.
Les présents résultats et la maitrise des techniques de cytogénétique utilisées en biodosimétrie, nous permettront d’envisager et de mettre en place un laboratoire de biodosimétrie sous forme d’une antenne au sein de LGMC, Université USTO, qui serait une référence à l’échelle nord-africaine et reconnu par les instances internationales
Directeur de thèse : BOUDJEMA Abdellah Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 1574 02-34-109 Version numérique et papier Bibliothèque USTOMB Thèse de Doctorat Exclu du prêt Documents numériques
02-34-109.pdfAdobe Acrobat PDFEtudes des déterminants génétiques des maladies oculaires dans l’Ouest Algérien cas du : Kératocône / METEOUKKI Wafaa

Titre : Etudes des déterminants génétiques des maladies oculaires dans l’Ouest Algérien cas du : Kératocône Type de document : texte imprimé Auteurs : METEOUKKI Wafaa, Auteur Année de publication : 2021-2022 Accompagnement : CD Langues : Français (fre) Catégories : biologie moléculaire Mots-clés : Kératocône, CAT, GPX-1, IL-4, FoxP3, Polymorphismes, Ouest Algérien.
Keratoconus, CAT, GPX-1, IL-4, FoxP3, Polymorphisms, West Algeria.Résumé : Le Kératocône (KC) est une dystrophie cornéenne et une indication majeure pour la
transplantation de la cornée dans le monde. Cette pathologie dont l’étiologie est mal connue combine
l’implication de facteurs génétiques et environnementaux. A ce jour aucun gène n'a encore été
définitivement identifié comme étant causal pour cette maladie.
Le but de notre étude a été tout d’abord d’étudier l’impact de certains facteurs environnementaux
sur la prédisposition au développement de la maladie et par la suite, nous nous sommes intéressés à la
recherche d’une association entre les polymorphismes : [CAT] rs7943316 (A>T), [GPX-1] rs1050450,
[IL-4] rs2070874 (C>T), [FoxP3] rs3761548 (T>G) et le risque du développement du Kératocône
Cette étude a été réalisée sur un échantillon composé de 120 cas et 200 témoins, les sujets étaient
non apparentés et originaires de l’Ouest Algérien. Le génotypage des polymorphismes du gène IL-4 et
du gène FoxP3 a été réalisé par la technique de discrimination allélique en temps réel (TaqMan) et par la
PCR-RFLP pour les polymorphismes du gène CAT et le gène GPX-1. La comparaison des fréquences
génotypiques et alléliques entre le groupe des cas et le groupe des témoins a été établie par le calcul de
l’odds ratio avec un intervalle de confiance à 95%.
Nos résultats ont montré, qu’il existerait une association entre les facteurs de risques
environnementaux tels que l’histoire familiale, l’allergie et le frottement oculaire avec le développement
du Kératocône. Dans un second temps, nos résultats ont montré qu’il n’existe aucune association
significative entre les polymorphismes rs1050450 du gène GPX-1, rs2070874 du gène IL-4 et le
rs3761548 du gène FoxP3 avec le risque du développement du Kératocône dans la population de l’Ouest
Algérien (P>0,05). Par ailleurs nous avons trouvé que le génotype CAT -21TT et l’allèle CAT-21T étaient
associés avec l’augmentation significative du risque de survenue du Kératocône (P= 9x10-5
; OR = 2,96)
et (P=1x10-4
; OR = 2,11) respectivement. Aucune association n’a été trouvée entre les SNPs des gènes
CAT et GPX-1 et les stades de l’’évolution du Kératocône.
En conclusion, il serait intéressant d’élargir l’étude sur un échantillon plus important et aussi
d’explorer d’autres polymorphismes aux niveaux d’autres gènes candidats, ceci afin de confirmer nos
résultats et aussi pour mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques à l’origine de cette
maladie.
Keratoconus (KC) is a corneal dystrophy and a major indication for corneal transplantation
worldwide. This pathology, whose etiology is poorly understood, combines the involvement of genetic
and environmental factors. To date, no gene has yet been definitively identified as being causative for
this disease.
The aim of our study was first of all to study the impact of certain environmental factors on the
predisposition to the development of the disease and then, we were interested in the search for an
association between the polymorphisms: [CAT] rs7943316 (A> T), [GPX-1] rs1050450, [IL-4]
rs2070874 (C> T), [FoxP3] rs3761548 (T> G) and the risk of the development of Keratoconus.
This study was performed on a sample of 120 cases and 200 controls, the subjects were unrelated
and from western Algeria. The genotyping of the polymorphisms of the IL-4 gene and of the FoxP3
gene was carried out by the technique of real-time allelic discrimination (TaqMan) and by PCR-RFLP
for the polymorphisms of the CAT gene and the GPX-1 gene. The comparison of genotypic and allelic
frequencies between the case group and the control group was established by calculating the odds ratio
with a 95% confidence interval.
Our results showed that there is an association between environmental risk factors such as family
history, allergy and eye rubbing with the development of Keratoconus. Secondly, our results showed
that there is no significant association between the rs1050450 polymorphisms of the GPX-1 gene,
rs2070874 of the IL-4 gene and the rs3761548 of the FoxP3 gene with the risk of the development of
Keratoconus in the population from West Algeria (P> 0.05). In addition, we found that the CAT -21TT
genotype and the CAT-21T allele were associated with the significant increase in the risk of occurrence
of Keratoconus (P = 9x10-5
; OR = 2.96) and (P = 1x10- 4
; OR = 2.11) respectively. No association was
found between the SNPs of the CAT and GPX-1 genes and the stages of the evolution of Keratoconus.
In conclusion, it would be interesting to extend the study to a larger sample and also to explore other
polymorphisms at the level of other candidate genes, in order to confirm our results and also to better
understand the physiopathological mechanisms at the origin of this disease.
Directeur de thèse : MEROUFEL Djabaria Naima Etudes des déterminants génétiques des maladies oculaires dans l’Ouest Algérien cas du : Kératocône [texte imprimé] / METEOUKKI Wafaa, Auteur . - 2021-2022 . - + CD.
Langues : Français (fre)
Catégories : biologie moléculaire Mots-clés : Kératocône, CAT, GPX-1, IL-4, FoxP3, Polymorphismes, Ouest Algérien.
Keratoconus, CAT, GPX-1, IL-4, FoxP3, Polymorphisms, West Algeria.Résumé : Le Kératocône (KC) est une dystrophie cornéenne et une indication majeure pour la
transplantation de la cornée dans le monde. Cette pathologie dont l’étiologie est mal connue combine
l’implication de facteurs génétiques et environnementaux. A ce jour aucun gène n'a encore été
définitivement identifié comme étant causal pour cette maladie.
Le but de notre étude a été tout d’abord d’étudier l’impact de certains facteurs environnementaux
sur la prédisposition au développement de la maladie et par la suite, nous nous sommes intéressés à la
recherche d’une association entre les polymorphismes : [CAT] rs7943316 (A>T), [GPX-1] rs1050450,
[IL-4] rs2070874 (C>T), [FoxP3] rs3761548 (T>G) et le risque du développement du Kératocône
Cette étude a été réalisée sur un échantillon composé de 120 cas et 200 témoins, les sujets étaient
non apparentés et originaires de l’Ouest Algérien. Le génotypage des polymorphismes du gène IL-4 et
du gène FoxP3 a été réalisé par la technique de discrimination allélique en temps réel (TaqMan) et par la
PCR-RFLP pour les polymorphismes du gène CAT et le gène GPX-1. La comparaison des fréquences
génotypiques et alléliques entre le groupe des cas et le groupe des témoins a été établie par le calcul de
l’odds ratio avec un intervalle de confiance à 95%.
Nos résultats ont montré, qu’il existerait une association entre les facteurs de risques
environnementaux tels que l’histoire familiale, l’allergie et le frottement oculaire avec le développement
du Kératocône. Dans un second temps, nos résultats ont montré qu’il n’existe aucune association
significative entre les polymorphismes rs1050450 du gène GPX-1, rs2070874 du gène IL-4 et le
rs3761548 du gène FoxP3 avec le risque du développement du Kératocône dans la population de l’Ouest
Algérien (P>0,05). Par ailleurs nous avons trouvé que le génotype CAT -21TT et l’allèle CAT-21T étaient
associés avec l’augmentation significative du risque de survenue du Kératocône (P= 9x10-5
; OR = 2,96)
et (P=1x10-4
; OR = 2,11) respectivement. Aucune association n’a été trouvée entre les SNPs des gènes
CAT et GPX-1 et les stades de l’’évolution du Kératocône.
En conclusion, il serait intéressant d’élargir l’étude sur un échantillon plus important et aussi
d’explorer d’autres polymorphismes aux niveaux d’autres gènes candidats, ceci afin de confirmer nos
résultats et aussi pour mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques à l’origine de cette
maladie.
Keratoconus (KC) is a corneal dystrophy and a major indication for corneal transplantation
worldwide. This pathology, whose etiology is poorly understood, combines the involvement of genetic
and environmental factors. To date, no gene has yet been definitively identified as being causative for
this disease.
The aim of our study was first of all to study the impact of certain environmental factors on the
predisposition to the development of the disease and then, we were interested in the search for an
association between the polymorphisms: [CAT] rs7943316 (A> T), [GPX-1] rs1050450, [IL-4]
rs2070874 (C> T), [FoxP3] rs3761548 (T> G) and the risk of the development of Keratoconus.
This study was performed on a sample of 120 cases and 200 controls, the subjects were unrelated
and from western Algeria. The genotyping of the polymorphisms of the IL-4 gene and of the FoxP3
gene was carried out by the technique of real-time allelic discrimination (TaqMan) and by PCR-RFLP
for the polymorphisms of the CAT gene and the GPX-1 gene. The comparison of genotypic and allelic
frequencies between the case group and the control group was established by calculating the odds ratio
with a 95% confidence interval.
Our results showed that there is an association between environmental risk factors such as family
history, allergy and eye rubbing with the development of Keratoconus. Secondly, our results showed
that there is no significant association between the rs1050450 polymorphisms of the GPX-1 gene,
rs2070874 of the IL-4 gene and the rs3761548 of the FoxP3 gene with the risk of the development of
Keratoconus in the population from West Algeria (P> 0.05). In addition, we found that the CAT -21TT
genotype and the CAT-21T allele were associated with the significant increase in the risk of occurrence
of Keratoconus (P = 9x10-5
; OR = 2.96) and (P = 1x10- 4
; OR = 2.11) respectively. No association was
found between the SNPs of the CAT and GPX-1 genes and the stages of the evolution of Keratoconus.
In conclusion, it would be interesting to extend the study to a larger sample and also to explore other
polymorphisms at the level of other candidate genes, in order to confirm our results and also to better
understand the physiopathological mechanisms at the origin of this disease.
Directeur de thèse : MEROUFEL Djabaria Naima Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 9000 02-34-124 Version numérique et papier Bibliothèque USTOMB Thèse de Doctorat Exclu du prêt Documents numériques
02-34-124.pdfAdobe Acrobat PDF
BUC USTOMB'Thèses

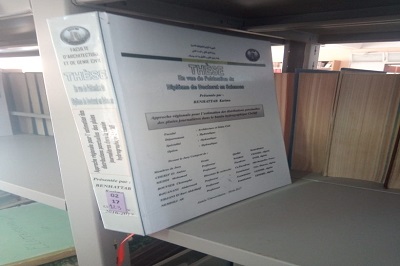

Service Thèse de la BUC met à votre disposition L'ensemble des thèses de doctorat et mémoires de magister soutenues à l'USTO MB
Adresse
BUC USTOMB'ThèsesBibliothèque centrale USTOMB
BP 1505 EL M'Naouer USTO ORAN
Algérie
(213)041627180
contact