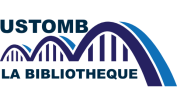les Thèses Soutenues à l'USTO MB
vous cherchez une thèse?
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les recherches... | Votre compte |
Détail de l'auteur
Auteur DJERADI Mustapha Ameur
Documents disponibles écrits par cet auteur


 Faire une suggestion Affiner la recherche
Faire une suggestion Affiner la recherche
Titre : Espace de la mort et fondation des cités Type de document : texte imprimé Auteurs : DJERADI Mustapha Ameur, Auteur Année de publication : 2020-2021 Accompagnement : CD Langues : Français (fre) Catégories : Architecture:Architecture Mots-clés : Cité Espace de la mort fondation Ĝşar sacré Walî
City Ĝşar foundation sacred Space of death Walî.Résumé : Le mort est une entité qui existe, à laquelle on rend visite et qui garde sa place parmi les vivants. Cette existence du mort induit l'existence d'un espace de la mort. Notre question est : Quelle est la place et le rôle de la mort dans la fondation des cités ? À contre-courant de l’évidence établie, la genèse des cités prend racines dans un vécu "spirituel" lié à la mort. L’objectif est de montrer de quelle manière l’organisation de l’espace habité d’ici-bas est liée à la mort et ses représentations.
A travers une vision rétrospective, je perçus la place du cimetière et saisis sa typologie. À partir de cette vision rétrospective et par l’approche axiologique, je posai les prémices d’une vision prospectives de l’espace de la mort. L’idée à retenir fut de traiter le cimetière entant que "seuil Urbain". Pour les logiques fondatrices, elles sont ancrées dans la mémoire collective et évoquées par les récits hagiographiques. Je captai cinq facteurs de fondation. Le premier facteur est la violence et ses représentations. J’insistai sur l’impact de la violence sur la configuration spatiale de l’espace ĝşûrien. Le deuxième est la mort, la tombe est la première demeure fixe de l’homme. La cité fut d'abord un lieu de rencontre autour et pour le mort. Le troisième facteur est la fête. Celle-ci régénère le ĝşar. Au moment de la fête, on rejoue la fondation telle que cela s'est passé. Au quatrième plan c’est la parole oraculaire. Le fondateur, s’en alla créer un autre ĝşar, sous l’impulsion d’une parole venue d’un Maître ou d’un anonyme. Au cinquième plan l'errance. Un territoire peuplé eut toujours un patron. Ce furent ces pérégrinations qui construisirent le lieu. Ces ermitages balisèrent et structurèrent le territoire. Ces cités qu’on considère comme le produit d'une spontanéité se révèlent être le produit d'une planification rigoureuse et plus complexe que la planification techniciste, en ce sens où elle a pris en compte non seulement le factuel mais encore et surtout l’immatériel : le sacré.
The dead person is an entity that exists, to which we visit and which keeps its
place among the living. This existence of the dead induces the existence of a space of
death. Our question is: What is the place and role of death in the foundation of
cities? Against the tide of established evidence, the genesis of cities takes root in a
"spiritual" experience linked to death. The objective is to show how the organization
of the inhabited space here below is linked to death and its representations.
Through a retrospective vision, we perceived the place of the cemetery and
understood its typology. From this retrospective view and through the axiological
approach, we have laid the groundwork for a prospective view of the space of death.
The idea to remember is to treat the cemetery as an "Urban threshold". For the
founding logics, they are anchored in the collective memory and evoked by
hagiographic accounts. We have captured five foundational factors. The first factor is
violence and its representations. We have insisted on the impact of violence on the
spatial configuration of the ĝşûrien space. The second is death; we have understood
that the grave is the first fixed abode of man. The city was first of all a meeting place
around and for the dead. The third factor is the party. This regenerates the ĝşar. At
the time of the feast, we replay the foundation as it happened. In the fourth level is
the oracular speech. The founder was going to create another ĝşar, under the impetus
of a word from a Master or an anonymous person. In the fifth plan, wandering. A
populated territory always had a boss. It is these peregrinations that built the place.
These hermitages marked out and structured the territory.
These cities that we see as the product of spontaneity turn out to be the
product of rigorous planning and more complex than technical planning, in the sense
that it has taken into account not only the factual but also and above all the
intangible: the sacred.
Directeur de thèse : BENKOULA Sidi mohamed El Habib Espace de la mort et fondation des cités [texte imprimé] / DJERADI Mustapha Ameur, Auteur . - 2020-2021 . - + CD.
Langues : Français (fre)
Catégories : Architecture:Architecture Mots-clés : Cité Espace de la mort fondation Ĝşar sacré Walî
City Ĝşar foundation sacred Space of death Walî.Résumé : Le mort est une entité qui existe, à laquelle on rend visite et qui garde sa place parmi les vivants. Cette existence du mort induit l'existence d'un espace de la mort. Notre question est : Quelle est la place et le rôle de la mort dans la fondation des cités ? À contre-courant de l’évidence établie, la genèse des cités prend racines dans un vécu "spirituel" lié à la mort. L’objectif est de montrer de quelle manière l’organisation de l’espace habité d’ici-bas est liée à la mort et ses représentations.
A travers une vision rétrospective, je perçus la place du cimetière et saisis sa typologie. À partir de cette vision rétrospective et par l’approche axiologique, je posai les prémices d’une vision prospectives de l’espace de la mort. L’idée à retenir fut de traiter le cimetière entant que "seuil Urbain". Pour les logiques fondatrices, elles sont ancrées dans la mémoire collective et évoquées par les récits hagiographiques. Je captai cinq facteurs de fondation. Le premier facteur est la violence et ses représentations. J’insistai sur l’impact de la violence sur la configuration spatiale de l’espace ĝşûrien. Le deuxième est la mort, la tombe est la première demeure fixe de l’homme. La cité fut d'abord un lieu de rencontre autour et pour le mort. Le troisième facteur est la fête. Celle-ci régénère le ĝşar. Au moment de la fête, on rejoue la fondation telle que cela s'est passé. Au quatrième plan c’est la parole oraculaire. Le fondateur, s’en alla créer un autre ĝşar, sous l’impulsion d’une parole venue d’un Maître ou d’un anonyme. Au cinquième plan l'errance. Un territoire peuplé eut toujours un patron. Ce furent ces pérégrinations qui construisirent le lieu. Ces ermitages balisèrent et structurèrent le territoire. Ces cités qu’on considère comme le produit d'une spontanéité se révèlent être le produit d'une planification rigoureuse et plus complexe que la planification techniciste, en ce sens où elle a pris en compte non seulement le factuel mais encore et surtout l’immatériel : le sacré.
The dead person is an entity that exists, to which we visit and which keeps its
place among the living. This existence of the dead induces the existence of a space of
death. Our question is: What is the place and role of death in the foundation of
cities? Against the tide of established evidence, the genesis of cities takes root in a
"spiritual" experience linked to death. The objective is to show how the organization
of the inhabited space here below is linked to death and its representations.
Through a retrospective vision, we perceived the place of the cemetery and
understood its typology. From this retrospective view and through the axiological
approach, we have laid the groundwork for a prospective view of the space of death.
The idea to remember is to treat the cemetery as an "Urban threshold". For the
founding logics, they are anchored in the collective memory and evoked by
hagiographic accounts. We have captured five foundational factors. The first factor is
violence and its representations. We have insisted on the impact of violence on the
spatial configuration of the ĝşûrien space. The second is death; we have understood
that the grave is the first fixed abode of man. The city was first of all a meeting place
around and for the dead. The third factor is the party. This regenerates the ĝşar. At
the time of the feast, we replay the foundation as it happened. In the fourth level is
the oracular speech. The founder was going to create another ĝşar, under the impetus
of a word from a Master or an anonymous person. In the fifth plan, wandering. A
populated territory always had a boss. It is these peregrinations that built the place.
These hermitages marked out and structured the territory.
These cities that we see as the product of spontaneity turn out to be the
product of rigorous planning and more complex than technical planning, in the sense
that it has taken into account not only the factual but also and above all the
intangible: the sacred.
Directeur de thèse : BENKOULA Sidi mohamed El Habib Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 1851 02-14-207 Version numérique et papier Bibliothèque USTOMB Thèse de Doctorat Exclu du prêt Documents numériques
02-14-207.pdfAdobe Acrobat PDF
BUC USTOMB'Thèses

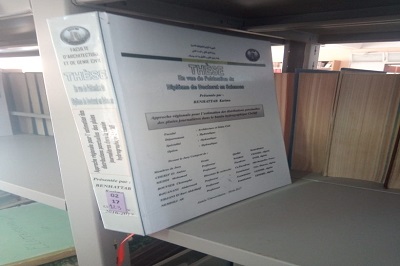

Service Thèse de la BUC met à votre disposition L'ensemble des thèses de doctorat et mémoires de magister soutenues à l'USTO MB
Adresse
BUC USTOMB'ThèsesBibliothèque centrale USTOMB
BP 1505 EL M'Naouer USTO ORAN
Algérie
(213)041627180
contact