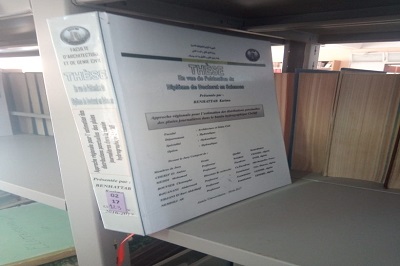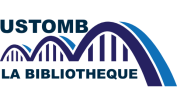|
| Titre : | Synthèse, Caractérisation d’hydroxydes lamellaires type Cu-M (M = Al, Fe) et application dans le traitement de l’eau | | Type de document : | document électronique | | Auteurs : | BEKKOUCHE Mohamed, Auteur ; BETTAHAR Nourredine, Directeur de thèse | | Année de publication : | 2014 | | Importance : | 128 p. | | Accompagnement : | CD | | Langues : | Français (fre) | | Catégories : | CHIMIE:Option: Physicochimie des Matériaux Minéraux
| | Mots-clés : | HDL colorant industriel diffraction cinétique isotherme d’adsorption. | | Résumé : | La pollution des eaux, accidentelle ou volontaire, par des produits chimiques d’origine industrielle (hydrocarbures, phénols, colorants,…etc.) ou agricole (pesticides, engrais,…etc.) constitue une source de dégradation et de danger pour l’environnement aquatique. Elle suscite, l’heure actuelle, un intérêt particulier à l’échelle internationale.
L’importance, de plus en plus grande, attachée à la protection des milieux naturels et à l’amélioration de la qualité des eaux ne cesse de croître et les différentes instances internationales avec les associations non gouvernementales chargées d’inspecter et de surveiller l’environnement, sonnent l’alarme à l’occasion de chaque catastrophe et proposent des réglementations de plus en plus strictes.
D’énormes investissements, dans tous les domaines, ont été utilisés pour l’élimination de la pollution et conserver un environnement plus ou moins sain pour l’être humain.
La qualité d’eau est aujourd’hui tributaire d’une présence de substances organiques souvent toxiques dans les effluents. Par exemple, les colorants utilisés dans l’impression, la teinture textile, le papier, le cuir, le bois et les matières plastiques représentent un facteur élevé de pollution aquatique. Des études réalisées sur l’action des colorants sur l’environnement ont montré qu’ils présentent un caractère toxique vis-à-vis du milieu aquatique et de récentes estimations indiquent qu’environ 20 % des colorants disparaissent pendant les opérations du procédé industriel de coloration. Cette quantité de colorant perdue se retrouve le plus souvent dans l’atmosphère ou dans le milieu marin. Certains de ces colorants causent de sérieux problèmes à l’environnement en raison de leur stabilité et de leur faible biodégradabilité.
Plusieurs colorants et pigments sont toxiques et ont un effet mutagène et carcinogène qui affecte l’environnement aquatique et humain ; on estime que 9 % de la quantité totale des colorants produits par le monde est déchargée par les effluents textiles.
Dans certaines régions de l’Algérie et à cause de la sécheresse, les agriculteurs continuent à irriguer leurs terres avec les eaux de rejet qui se trouvent fortement concentrées et peuvent ainsi arriver, par le biais de la chaîne alimentaire, jusqu’à l’homme.
Les chercheurs de différents horizons (chimie, géologie, agronomie, biologie, médecine, …etc.) s’intéressent de plus en plus à l’identification et à l’élimination de la pollution impliquée directement dans l’apparition de déséquilibres au niveau des écosystèmes ou à l’origine de troubles graves pouvant conduire à la mort, aussi bien chez les animaux que chez l’homme.
Les procédés classiques de purification ont montré leurs limites ; par exemple, la coagulation-floculation-décantation ne permettent pas un abattement suffisant de la pollution par ces composés organiques et l’utilisation du charbon actif en poudre (cap) en tête de la filière de traitement est souvent complétée par la mise en œuvre des procédés de traitement par adsorption.
Depuis les années 1980, de nombreux laboratoires s’intéressent à la mise au point de nouveaux adsorbants ; c’est ainsi qu’ont été utilisés des matériaux comme les hydrotalcites ou argiles anioniques synthétiques dans le traitement des effluents par adsorption ou comme catalyseurs de réactions de dégradation des polluants (comme catalyseurs ou comme supports de catalyseurs). En outre, ils peuvent être utilisés en échange anionique et en industrie pharmaceutique.
Dans le domaine de l’adsorption, en milieu aqueux, ce sont surtout les argiles insérées par des tensioactifs, qui ont été utilisées dans le traitement de la matière organique. Bien que celles-ci aient manifesté des affinités vis-à-vis de certains composés organiques hydrosolubles, elles se sont avérées néanmoins thermiquement instables. D’autres travaux ont trouvé que les hydroxydes doubles lamellaires, représentent une nouvelle classe d’adsorbants minéraux, en remplaçant les ions de compensation par des ions organiques (cas des colorants anioniques). Ils trouvent d’importantes applications dans différents domaines en raison des combinaisons très variées d’éléments chimiques constitutifs des feuillets et des entités inter lamellaires. L’importance de leur structure a fait que ces composés connaissent un intérêt très important en industrie. L’intérêt grandissant envers ces matériaux est essentiellement dû à la facilité de leur synthèse, à la variabilité des cations métalliques et à leur stabilité thermique.
Les anions les plus rencontrés dans l’espace inter foliaire ces matériaux sont les ions carbonates. Ces derniers présentent une grande affinité pour ces matrices et par conséquent ils sont difficilement échangeables.
Un traitement de calcination mène à la formation d’un mélange d’oxydes mixtes des métaux divalents et trivalents qui, par réhydratation en présence d’une espèce anionique choisie, sous atmosphère exemple de CO2, redonne une nouvelle phase HDL intercalée par la nouvelle espèce d’anions. Ainsi ces espèces insérées entre les feuilles donnent lieu à de nouvelles structures cristallines, avec une modification de la distance inter foliaire. L’intercalation de tensioactifs anioniques dans les HDL conduit aux plus fortes dilatations structurales observées, avec des distances inter lamellaires dix fois plus grandes que l’épaisseur d’un feuillet.
Nous avons utilisé, dans ce travail, les matériaux [Cu-Fe-CO3], [Cu-Al-CO3] et les produis calcinés chaque phase citée afin d’éliminer les colorants : Jaune Titan et le Bleu Trypan.
Le travail présenté se divise en deux grandes parties. La première est consacrée à une étude théorique bibliographique, notamment une présentation structurale et les propriétés caractéristiques des hydroxydes doubles lamellaires (HDL) suivie d’une description des colorants et les notions sur le phénomène d’adsorption.
Dans la deuxième partie de ce travail, nous nous sommes proposés d’utiliser les matériaux, à base de cuivre (+2), de fer (+3) et d’aluminium (+3) : [Cu-Fe-CO3], [Cu-Al-CO3] en variant le rapport molaire et leurs produits calcinés à 250°C et 350°C respectivement.
La méthode de synthèse utilisée est la coprécipitation à pH constant et les solides formés sont caractérisés par diffraction des rayons X (DRX), par spectroscopie infra rouge (FTIR( et par analyses thermiques (ATD et ATG).
Après synthèse et caractérisation, une étude expérimentale portant sur l'élimination par adsorption des deux colorants cités précédemment a fait l’objet de nos investigations. A cet effet nous avons étudiés quelques paramètres importants sur le pouvoir de rétention de ces matériaux testés en particulier l’effet du rapport molaire Cu/Fe et Cu/Al, la cinétique d'adsorption, la concentration en colorant, la masse du matériau, le pH de la solution.
Enfin, une conclusion générale résume l’essentiel de nos résultats.
Le travail réalisé s’inscrit dans une perspective de contribution dans le domaine de l’environnement. La problématique de la pollution des eaux étant d’une actualité cruciale, l’idée est de trouver les moyens visant à réduire les coûts des traitements et à minimiser les rejets polluant cet environnement.
L’objectif de l’étude consistait à exploiter une nouvelle variété de matériaux dans la rétention et l’élimination de colorants issus de l’industrie textile. Nous avons choisi le Bleu Trypan et le Jaune Titan.
Ces colorants ont été éliminés par adsorption à partir de solutions aqueuses. Les matériaux utilisés sont de type HDL, caractérisés par un empilement de feuillets composés de métaux divalents et trivalents et chargés positivement (dans notre cas M+2=Cu+2 et, M+3=Fe+3 et Al+3). Ces feuillets étant séparés par des domaines inter feuillets dans lesquels se fixent ces colorants anioniques.
Les expériences d’élimination suivies par une modélisation des résultats ont montré des résultats intéressants tant pour la cinétique que pour les isothermes. Outre le fait de traiter la pollution des eaux, nous nous sommes familiarisé avec les diverses techniques de synthèse, de caractérisation de ces matériaux et particulièrement leur intérêt dans les applications de dépollution des rejets industriels provenant de diverses industries (textile, papier, tanneries…etc.).
Pour l’adsorption des colorants, nous avons utilisé les matériaux carbonatés [Cu-Al-CO3] avec un rapport molaire R=MII/MIII égal à 1, 2, 3 et 4 et [Cu-Fe-CO3] avec R=3 et 4. La calcination de ces produits a donné une autre variété de matériaux qui ont été, à leur tour, utilisé comme adsorbants ; les températures de calcination étant de 350°C pour [Cu-Al-350] et 250°C pour [Cu-Fe-250].
Ces matériaux ont été obtenus par synthèse par coprécipitation à pH constant et leurs caractérisations ont été faites par les techniques de diffraction des rayons X (DRX), par spectroscopie infra rouge (FTIR), et par analyses thermiques (ATD et ATG). Avant toute expérience de rétention, nous avons confirmé qu’il s’agissait bien d’hydroxydes doubles lamellaires recherchés.Lors des expériences de fixation du colorant sur les matériaux, plusieurs paramètres qui ont une influence sur la capacité d’élimination du colorant ont été examinés. Les investigations ont notamment portés sur les cinétiques d’adsorption, les isothermes, l’effet de pH de la solution, et la quantité de matériau.
L’étude comparative des paramètres d’adsorption des colorants sur les HDL et sur leurs produits calcinés révèle une grande capacité de sorption sur les matériaux calcinés. Les résultats des données cinétiques et des isothermes d’adsorption du colorant sur les matériaux obéissent au modèle cinétique du pseudo-second ordre et au modèle d’isotherme de Langmuir.
Pour [Cu-Fe-CO3] et [Cu-Fe-CO3], l’adsorption dépend du pH initial de la solution ; en effet, dans la gamme de pH comprise entre 2 et 6, il y a une augmentation et la fixation est maximale.
Pour [Cu- Fe -250] et [Cu-Al-350], c’est plutôt dans la gamme de pH supérieure à 6 que la fixation est maximale.
Une bien meilleure fixation a eu lieu dans le cas du Jaune Titan (JT) avec les matériaux carbonates et calcines qui présentent la plus grande capacité d’adsorption par rapport au Bleu Trypan (BT). L'adsorption (en quantité adsorbée) peut être résumée comme suit :
Pour les matériaux carbonates :
[Cu-Fe-CO3] + JT [Cu-Al-CO3] + JT [Cu-Fe-CO3] + BT [Cu-Al-CO3] +BT .
Pour les matériaux calcines :
[Cu-Fe-250] + JT [Cu-Al-350] + JT [Cu- Fe -250] + BT [Cu-Al-350] + BT .
Le taux d’élimination du Jaune Titan sur les matériaux calcinés est rapide et atteint des valeurs importantes au bout de 20 minutes pour [Cu-Fe-250] et [Cu-Al-350] avec un meilleur taux d’élimination autour de 97% et 99% respectivement.
Pour le Bleu Trypan, l’élimination de ce colorant sur les solides calcinés est aussi rapide et atteint des valeurs importantes au bout de 25 minutes et 35 minutes pour [Cu-Fe-250] et [Cu-Al-350] avec un taux avoisinant 91%.
Cette étude nous a permis de conclure que les hydroxydes doubles lamellaires carbonatés [Al-Cu-CO3], [Cu-Fe-CO3] et en particulier leurs produits de calcination peuvent bien être une alternative, à coût réduit, pour être utilisés dans des processus de purification des eaux usées par adsorption.
|
Synthèse, Caractérisation d’hydroxydes lamellaires type Cu-M (M = Al, Fe) et application dans le traitement de l’eau [document électronique] / BEKKOUCHE Mohamed, Auteur ; BETTAHAR Nourredine, Directeur de thèse . - 2014 . - 128 p. + CD. Langues : Français ( fre) | Catégories : | CHIMIE:Option: Physicochimie des Matériaux Minéraux
| | Mots-clés : | HDL colorant industriel diffraction cinétique isotherme d’adsorption. | | Résumé : | La pollution des eaux, accidentelle ou volontaire, par des produits chimiques d’origine industrielle (hydrocarbures, phénols, colorants,…etc.) ou agricole (pesticides, engrais,…etc.) constitue une source de dégradation et de danger pour l’environnement aquatique. Elle suscite, l’heure actuelle, un intérêt particulier à l’échelle internationale.
L’importance, de plus en plus grande, attachée à la protection des milieux naturels et à l’amélioration de la qualité des eaux ne cesse de croître et les différentes instances internationales avec les associations non gouvernementales chargées d’inspecter et de surveiller l’environnement, sonnent l’alarme à l’occasion de chaque catastrophe et proposent des réglementations de plus en plus strictes.
D’énormes investissements, dans tous les domaines, ont été utilisés pour l’élimination de la pollution et conserver un environnement plus ou moins sain pour l’être humain.
La qualité d’eau est aujourd’hui tributaire d’une présence de substances organiques souvent toxiques dans les effluents. Par exemple, les colorants utilisés dans l’impression, la teinture textile, le papier, le cuir, le bois et les matières plastiques représentent un facteur élevé de pollution aquatique. Des études réalisées sur l’action des colorants sur l’environnement ont montré qu’ils présentent un caractère toxique vis-à-vis du milieu aquatique et de récentes estimations indiquent qu’environ 20 % des colorants disparaissent pendant les opérations du procédé industriel de coloration. Cette quantité de colorant perdue se retrouve le plus souvent dans l’atmosphère ou dans le milieu marin. Certains de ces colorants causent de sérieux problèmes à l’environnement en raison de leur stabilité et de leur faible biodégradabilité.
Plusieurs colorants et pigments sont toxiques et ont un effet mutagène et carcinogène qui affecte l’environnement aquatique et humain ; on estime que 9 % de la quantité totale des colorants produits par le monde est déchargée par les effluents textiles.
Dans certaines régions de l’Algérie et à cause de la sécheresse, les agriculteurs continuent à irriguer leurs terres avec les eaux de rejet qui se trouvent fortement concentrées et peuvent ainsi arriver, par le biais de la chaîne alimentaire, jusqu’à l’homme.
Les chercheurs de différents horizons (chimie, géologie, agronomie, biologie, médecine, …etc.) s’intéressent de plus en plus à l’identification et à l’élimination de la pollution impliquée directement dans l’apparition de déséquilibres au niveau des écosystèmes ou à l’origine de troubles graves pouvant conduire à la mort, aussi bien chez les animaux que chez l’homme.
Les procédés classiques de purification ont montré leurs limites ; par exemple, la coagulation-floculation-décantation ne permettent pas un abattement suffisant de la pollution par ces composés organiques et l’utilisation du charbon actif en poudre (cap) en tête de la filière de traitement est souvent complétée par la mise en œuvre des procédés de traitement par adsorption.
Depuis les années 1980, de nombreux laboratoires s’intéressent à la mise au point de nouveaux adsorbants ; c’est ainsi qu’ont été utilisés des matériaux comme les hydrotalcites ou argiles anioniques synthétiques dans le traitement des effluents par adsorption ou comme catalyseurs de réactions de dégradation des polluants (comme catalyseurs ou comme supports de catalyseurs). En outre, ils peuvent être utilisés en échange anionique et en industrie pharmaceutique.
Dans le domaine de l’adsorption, en milieu aqueux, ce sont surtout les argiles insérées par des tensioactifs, qui ont été utilisées dans le traitement de la matière organique. Bien que celles-ci aient manifesté des affinités vis-à-vis de certains composés organiques hydrosolubles, elles se sont avérées néanmoins thermiquement instables. D’autres travaux ont trouvé que les hydroxydes doubles lamellaires, représentent une nouvelle classe d’adsorbants minéraux, en remplaçant les ions de compensation par des ions organiques (cas des colorants anioniques). Ils trouvent d’importantes applications dans différents domaines en raison des combinaisons très variées d’éléments chimiques constitutifs des feuillets et des entités inter lamellaires. L’importance de leur structure a fait que ces composés connaissent un intérêt très important en industrie. L’intérêt grandissant envers ces matériaux est essentiellement dû à la facilité de leur synthèse, à la variabilité des cations métalliques et à leur stabilité thermique.
Les anions les plus rencontrés dans l’espace inter foliaire ces matériaux sont les ions carbonates. Ces derniers présentent une grande affinité pour ces matrices et par conséquent ils sont difficilement échangeables.
Un traitement de calcination mène à la formation d’un mélange d’oxydes mixtes des métaux divalents et trivalents qui, par réhydratation en présence d’une espèce anionique choisie, sous atmosphère exemple de CO2, redonne une nouvelle phase HDL intercalée par la nouvelle espèce d’anions. Ainsi ces espèces insérées entre les feuilles donnent lieu à de nouvelles structures cristallines, avec une modification de la distance inter foliaire. L’intercalation de tensioactifs anioniques dans les HDL conduit aux plus fortes dilatations structurales observées, avec des distances inter lamellaires dix fois plus grandes que l’épaisseur d’un feuillet.
Nous avons utilisé, dans ce travail, les matériaux [Cu-Fe-CO3], [Cu-Al-CO3] et les produis calcinés chaque phase citée afin d’éliminer les colorants : Jaune Titan et le Bleu Trypan.
Le travail présenté se divise en deux grandes parties. La première est consacrée à une étude théorique bibliographique, notamment une présentation structurale et les propriétés caractéristiques des hydroxydes doubles lamellaires (HDL) suivie d’une description des colorants et les notions sur le phénomène d’adsorption.
Dans la deuxième partie de ce travail, nous nous sommes proposés d’utiliser les matériaux, à base de cuivre (+2), de fer (+3) et d’aluminium (+3) : [Cu-Fe-CO3], [Cu-Al-CO3] en variant le rapport molaire et leurs produits calcinés à 250°C et 350°C respectivement.
La méthode de synthèse utilisée est la coprécipitation à pH constant et les solides formés sont caractérisés par diffraction des rayons X (DRX), par spectroscopie infra rouge (FTIR( et par analyses thermiques (ATD et ATG).
Après synthèse et caractérisation, une étude expérimentale portant sur l'élimination par adsorption des deux colorants cités précédemment a fait l’objet de nos investigations. A cet effet nous avons étudiés quelques paramètres importants sur le pouvoir de rétention de ces matériaux testés en particulier l’effet du rapport molaire Cu/Fe et Cu/Al, la cinétique d'adsorption, la concentration en colorant, la masse du matériau, le pH de la solution.
Enfin, une conclusion générale résume l’essentiel de nos résultats.
Le travail réalisé s’inscrit dans une perspective de contribution dans le domaine de l’environnement. La problématique de la pollution des eaux étant d’une actualité cruciale, l’idée est de trouver les moyens visant à réduire les coûts des traitements et à minimiser les rejets polluant cet environnement.
L’objectif de l’étude consistait à exploiter une nouvelle variété de matériaux dans la rétention et l’élimination de colorants issus de l’industrie textile. Nous avons choisi le Bleu Trypan et le Jaune Titan.
Ces colorants ont été éliminés par adsorption à partir de solutions aqueuses. Les matériaux utilisés sont de type HDL, caractérisés par un empilement de feuillets composés de métaux divalents et trivalents et chargés positivement (dans notre cas M+2=Cu+2 et, M+3=Fe+3 et Al+3). Ces feuillets étant séparés par des domaines inter feuillets dans lesquels se fixent ces colorants anioniques.
Les expériences d’élimination suivies par une modélisation des résultats ont montré des résultats intéressants tant pour la cinétique que pour les isothermes. Outre le fait de traiter la pollution des eaux, nous nous sommes familiarisé avec les diverses techniques de synthèse, de caractérisation de ces matériaux et particulièrement leur intérêt dans les applications de dépollution des rejets industriels provenant de diverses industries (textile, papier, tanneries…etc.).
Pour l’adsorption des colorants, nous avons utilisé les matériaux carbonatés [Cu-Al-CO3] avec un rapport molaire R=MII/MIII égal à 1, 2, 3 et 4 et [Cu-Fe-CO3] avec R=3 et 4. La calcination de ces produits a donné une autre variété de matériaux qui ont été, à leur tour, utilisé comme adsorbants ; les températures de calcination étant de 350°C pour [Cu-Al-350] et 250°C pour [Cu-Fe-250].
Ces matériaux ont été obtenus par synthèse par coprécipitation à pH constant et leurs caractérisations ont été faites par les techniques de diffraction des rayons X (DRX), par spectroscopie infra rouge (FTIR), et par analyses thermiques (ATD et ATG). Avant toute expérience de rétention, nous avons confirmé qu’il s’agissait bien d’hydroxydes doubles lamellaires recherchés.Lors des expériences de fixation du colorant sur les matériaux, plusieurs paramètres qui ont une influence sur la capacité d’élimination du colorant ont été examinés. Les investigations ont notamment portés sur les cinétiques d’adsorption, les isothermes, l’effet de pH de la solution, et la quantité de matériau.
L’étude comparative des paramètres d’adsorption des colorants sur les HDL et sur leurs produits calcinés révèle une grande capacité de sorption sur les matériaux calcinés. Les résultats des données cinétiques et des isothermes d’adsorption du colorant sur les matériaux obéissent au modèle cinétique du pseudo-second ordre et au modèle d’isotherme de Langmuir.
Pour [Cu-Fe-CO3] et [Cu-Fe-CO3], l’adsorption dépend du pH initial de la solution ; en effet, dans la gamme de pH comprise entre 2 et 6, il y a une augmentation et la fixation est maximale.
Pour [Cu- Fe -250] et [Cu-Al-350], c’est plutôt dans la gamme de pH supérieure à 6 que la fixation est maximale.
Une bien meilleure fixation a eu lieu dans le cas du Jaune Titan (JT) avec les matériaux carbonates et calcines qui présentent la plus grande capacité d’adsorption par rapport au Bleu Trypan (BT). L'adsorption (en quantité adsorbée) peut être résumée comme suit :
Pour les matériaux carbonates :
[Cu-Fe-CO3] + JT [Cu-Al-CO3] + JT [Cu-Fe-CO3] + BT [Cu-Al-CO3] +BT .
Pour les matériaux calcines :
[Cu-Fe-250] + JT [Cu-Al-350] + JT [Cu- Fe -250] + BT [Cu-Al-350] + BT .
Le taux d’élimination du Jaune Titan sur les matériaux calcinés est rapide et atteint des valeurs importantes au bout de 20 minutes pour [Cu-Fe-250] et [Cu-Al-350] avec un meilleur taux d’élimination autour de 97% et 99% respectivement.
Pour le Bleu Trypan, l’élimination de ce colorant sur les solides calcinés est aussi rapide et atteint des valeurs importantes au bout de 25 minutes et 35 minutes pour [Cu-Fe-250] et [Cu-Al-350] avec un taux avoisinant 91%.
Cette étude nous a permis de conclure que les hydroxydes doubles lamellaires carbonatés [Al-Cu-CO3], [Cu-Fe-CO3] et en particulier leurs produits de calcination peuvent bien être une alternative, à coût réduit, pour être utilisés dans des processus de purification des eaux usées par adsorption.
|
|


 Faire une suggestion Affiner la recherche
Faire une suggestion Affiner la rechercheAmélioration de la Vitesse d'hydratation et de Durcissement d'un Ciment Pouzzolanique par L'Utilisation d'Accelerateurs de Prise / MEKKAOUI Fatiha

Etude de L’activité catalytique de la sépiolite dans les réactions de polymérisation du styrène et du tétrahydrofurane. / Assia BELARBI

Etude et Amélioration de L’activité Pouzzolanique de Certains Matériaux Silicates pour une Substitution partielle du Clinker dans le Ciment Portland / GERYVILLE Djohar

Synthèse, Caractérisation d’hydroxydes lamellaires type Cu-M (M = Al, Fe) et application dans le traitement de l’eau / BEKKOUCHE Mohamed

Synthèses, propriétés tensioactives et études biologiques des dérivées hétérocycliques et nucléosidiques de l’acide caproïque / TAIEB BRAHIMI Fawzia